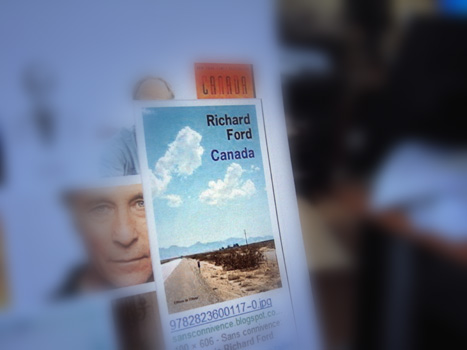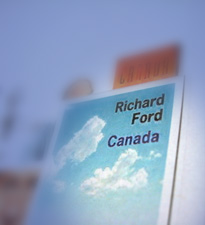 Et s’il n’en reste qu’un je serai celui là. C’est presqu’un châtiment que je me suis infligée en lisant jusqu’au point final l’ouvrage de Richard Ford intitulé « Canada ». Lecture opiniâtre avec un mental de chercheur d’or. Mais je n’ai pas trouvé de pépite dans ce livre qui figure pourtant au hit parade des meilleures ventes et qu’on dit sur les rangs pour un prix littéraire. Mise à part cette amusante expression imagée pour exprimer le stress malodorant des commandants de bord, « la piscine des aviateurs ».
Et s’il n’en reste qu’un je serai celui là. C’est presqu’un châtiment que je me suis infligée en lisant jusqu’au point final l’ouvrage de Richard Ford intitulé « Canada ». Lecture opiniâtre avec un mental de chercheur d’or. Mais je n’ai pas trouvé de pépite dans ce livre qui figure pourtant au hit parade des meilleures ventes et qu’on dit sur les rangs pour un prix littéraire. Mise à part cette amusante expression imagée pour exprimer le stress malodorant des commandants de bord, « la piscine des aviateurs ».
L’écrit raconte en trois parties les effets d’un piteux braquage de banque par des parents américains sur le devenir de leur fils, un adolescent en pleine construction. La première partie est consacrée aux préparatifs et à la réalisation du hold-up dans l’Amérique des années soixante. Le récit est méticuleux comme un relevé d’identité judiciaire, en complet décalage avec le caractère improvisé du braquage. La seconde partie d’égale longueur narre la vie du teen-ager une fois franchie la frontière américano-canadienne pour échapper à l’orphelinat promis à l’époque aux enfants mineurs de parents criminels. La courte dernière partie évoque ce qu’est devenu le héros, Dell, parvenu à l’âge de la retraite.
C’est Dell qui se raconte. Là réside le principal intérêt rhétorique du livre, dans cette narration rétrospective à la première personne. Mais on peut n’être pas passionné par son récit qui pourtant s’annonçait palpitant : «D’abord je vais vous raconter le hold-up que nos parents ont commis. Ensuite les meurtres, qui se sont produits plus tard. C’est le hold-up qui compte le plus, parce qu’il a eu pour effet d’infléchir le cours de nos vie à ma sœur et à moi»… L’accroche tient du pétard mouillé, les préparatifs du casse manqué auront surtout pour effet de modifier le train-train quotidien du narrateur. Pas de quoi fouetter un caribou.
On peine à s’intéresser aux ressorts psychologiques des personnages peu nombreux qui l’entourent. Alors qu’il y aurait matière à d’intéressants développements : un couple parental dépareillé, une fausse gémellité, un chasseur louche et un hôtelier étrange. Le narrateur les présente comme tels mais peine à nous convaincre de la pertinence de cette assertion. Les ressorts psychologiques de l’entourage pâtissent de la perception minimaliste de l’adolescent. Il y a comme un décalage, une absence de concordance de temps entre les faits vécus par l’enfant et leur narration par l’adulte.
Certains crieront au chef d’œuvre quand d’autres n’y verront que psychologie de Wal-Mart. Déception aussi pour le traitement du thème de la frontière qu’on peut trouver insuffisamment exploité : naissance du père en Alabama, profession exercée dans plusieurs villes américaines, préparation du braquage dans le Montana, hold-up dans l’Etat voisin du Nebraska, exil au Canada. Frustration encore dans le comparatif attendu entre le vécu aux USA et le vécu au Canada. Les rebondissements tardent à venir. Ils laissent le lecteur sur sa faim alors que sont décrits par le menu les sandwiches à la mortadelle que se confectionne le héros. Si le roman de Richard Ford provient des notes entreposées dans le même réfrigérateur, rien d’étonnant à lui trouver un goût de moisi*. Reste le visuel pointu des décors et la minutieuse chorégraphie des scènes de chasses à l’oie, des descriptions susceptibles d’alimenter un script cinématographique. D’autant que l’auteur porte déjà un patronyme à la gloire du cinéma américain.
Traduit de l’anglais, l’ouvrage qui compte près de 500 pages et de nombreuses parenthèses est publié aux Editions de l’Olivier.
*Dans une interview au Monde titrée « Le roman qui venait du froid », Richard Ford confie avoir tiré la majeure partie de son roman de plusieurs centaines de notes enfouies dans son frigidaire trente ans auparavant pour les soustraire à la voracité de ses chiens.