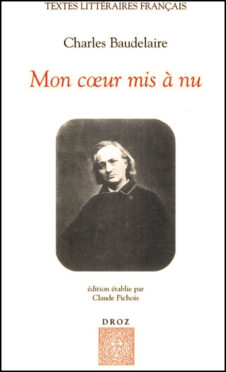 La poésie étant notoirement inutile -et probablement tout autant indispensable- certains de ses officiants se permettent d’aborder des domaines réservés en principe à d’autres, plus habiles dans le maniement des concepts. Avec une pointe d’ironie, Émile Cioran avait qualifié l’un de ces penseurs plus ou moins officiels « d’entrepreneur d’idées » (1). À l’inverse des étudiants et des professeurs, poètes et artistes ne s’embarrassent généralement pas d’analyse intellectuelle pour transmettre leurs émotions. Leur qualité de « voyant » (on ne remerciera jamais assez Arthur Rimbaud !) leur permet d’étonnantes prémonitions.
La poésie étant notoirement inutile -et probablement tout autant indispensable- certains de ses officiants se permettent d’aborder des domaines réservés en principe à d’autres, plus habiles dans le maniement des concepts. Avec une pointe d’ironie, Émile Cioran avait qualifié l’un de ces penseurs plus ou moins officiels « d’entrepreneur d’idées » (1). À l’inverse des étudiants et des professeurs, poètes et artistes ne s’embarrassent généralement pas d’analyse intellectuelle pour transmettre leurs émotions. Leur qualité de « voyant » (on ne remerciera jamais assez Arthur Rimbaud !) leur permet d’étonnantes prémonitions.
Lorsque Baudelaire meurt en 1867, dix ans après avoir publié « Les Fleurs du Mal », il ignorait que ses écrits personnels allaient lui survivre. Il fallut l’intervention de son éditeur Poulet-Malassis pour mettre de l’ordre dans ses feuillets griffonnés à la hâte. Le public découvrit alors ses journaux intimes, ou « fusées », le tout réuni sous le titre « Mon Cœur mis à nu ». Il s’agit assez souvent des coups de sang d’un atrabilaire ou des manifestations d’un désespoir très… baudelairien. Mais parfois, les écrits du poète possèdent un côté prémonitoire qui ne peut que surprendre le lecteur d’aujourd’hui. Ainsi ce passage où le poète pressent les méfaits de la mécanique « qui nous aura tellement américanisés » tandis que le progrès « aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle ». Plus étonnante encore cette remarque qu’il est difficile de ne pas rapprocher de certains événements outre-Atlantique: « Ce qui ressemblera à la vertu, que dis-je, tout ce qui ne sera pas l’ardeur vers Plutus {dieu de la richesse} sera réputé un immense ridicule. La justice, si, à cette époque fortunée, il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune ». Certes, Baudelaire avoue sentir quelquefois en lui « le ridicule d’un prophète », mais on ne peut que s’incliner devant une telle intuition.
Quelques décennies et une guerre mondiale plus tard, les nombreux mouvements avant-gardistes, futuristes, surréalistes, et autres « istes » se vantaient de favoriser avec enthousiasme un certain monde moderne. Mais la réalité ne fut pas toujours celle à laquelle s’attendaient ces jeunes gens impétueux. Le peintre touche-à-tout Francis Picabia fit preuve parfois dans ses écrits d’une étonnante sagacité. Dans le précieux numéro 16 de la revue anversoise d’avant-garde Ça Ira, consacrée au mouvement Dada, on trouve son article « écrit le 2 juillet 1921 à 10 h du matin » comme il le précise, sous le titre “ Bonheur physique et bonheur moral “: « Actuellement l’exagération du sport, l’importance qu’on lui donne en ont fait un art; le respect qu’on a pour tel ou tel boxeur se montre aussi grand que celui qu’on peut professer pour un ingénieur génial ou un artiste renommé; et certes un docteur qui sauverait une partie de l’humanité d’une affreuse épidémie ne serait pas porté en triomphe de façon plus tumultueuse que (les boxeurs) Georges Carpentier ou Dempsey ». On pourra aisément remplacer les noms de ces boxeurs très populaires en leur temps par ceux de quelques grands joueurs de ballon rond déifiés aujourd’hui sans dénaturer le propos.
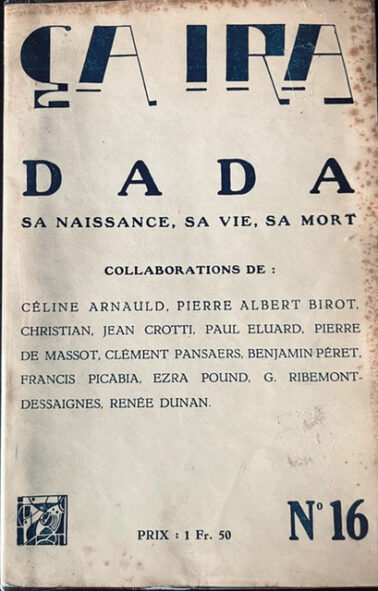 Francis Picabia dont le directeur de Ça Ira, Paul Neuhuys, dit qu’il « éprouve un plaisir innocent à lancer des boules puantes dans les écoles et les académies », se livre également dans ce même article à une diatribe forcément féroce contre le nouvel État russe. Rappelons que La Révolution d’octobre a eu lieu quatre ans auparavant: « La seule chose qui m’ait intéressé un instant chez les Russes, ce fut la révolution mais elle ne dura que quelques semaines et maintenant ils ont le même esprit « famille bourgeoise » qu’ici. »
Francis Picabia dont le directeur de Ça Ira, Paul Neuhuys, dit qu’il « éprouve un plaisir innocent à lancer des boules puantes dans les écoles et les académies », se livre également dans ce même article à une diatribe forcément féroce contre le nouvel État russe. Rappelons que La Révolution d’octobre a eu lieu quatre ans auparavant: « La seule chose qui m’ait intéressé un instant chez les Russes, ce fut la révolution mais elle ne dura que quelques semaines et maintenant ils ont le même esprit « famille bourgeoise » qu’ici. »
L’artiste ne met pas de gants pour fustiger la nouvelle société: « La révolution a exterminé les imbécillités tsaristes pour les remplacer par d’autres absurdités qui nous apparaissent avec les mêmes exagérations opportunistes que celles enfantées par le capitalisme autocrate du gouvernement impérial. »
Entre Baudelaire et Picabia, Rimbaud apparut comme un astre filant. Sa « Lettre du Voyant » est devenue le manifeste le plus éclatant de toute la poésie. Chercheurs et universitaires s’en sont emparé, et ce texte fondateur est aujourd’hui un casse-tête pour les lycéens qui n’ont rien demandé. Peut-être aurait-il fallu s’en tenir à Baudelaire qui, dans son projet de préface aux Fleurs du Mal, écrit: « Ceux qui savent me devinent, et pour les autres, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas me comprendre, j’amoncellerais sans fruits les explications. »
Gérard Goutierre

