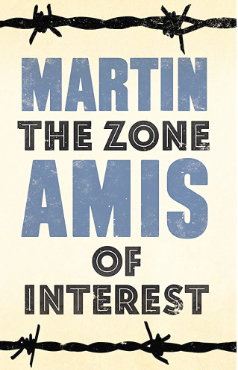 Les écrivains croient beaucoup aux coïncidences de l’existence, et le dernier festival de Cannes en est l’illustration : le grand satiriste anglais Martin Amis (prononcer Amisse) est mort à 73 ans le jour de la présentation du film inspiré de son roman «La zone d’intérêt» («The Zone of Interest»). Réalisé par le cinéaste anglais Jonathan Glazer («Under the skin», 2013), récompensé par le grand prix, le film est réputé glaçant. Il est vrai que le quatorzième roman de l’écrivain, paru en 2014, se situe en lisière du camp d’Auschwitz (jamais nommé mais reconnaissable). La zone d’intérêt était l’appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration.
Les écrivains croient beaucoup aux coïncidences de l’existence, et le dernier festival de Cannes en est l’illustration : le grand satiriste anglais Martin Amis (prononcer Amisse) est mort à 73 ans le jour de la présentation du film inspiré de son roman «La zone d’intérêt» («The Zone of Interest»). Réalisé par le cinéaste anglais Jonathan Glazer («Under the skin», 2013), récompensé par le grand prix, le film est réputé glaçant. Il est vrai que le quatorzième roman de l’écrivain, paru en 2014, se situe en lisière du camp d’Auschwitz (jamais nommé mais reconnaissable). La zone d’intérêt était l’appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration.
Nous suivons les intrigues sentimentales et autres vécues par quatre sinistres bouffons nazis, à commencer par le commandant du camp et sa belle petite famille aryenne.
S’il n’est pas très connu en France, Martin Amis est reconnu depuis longtemps outre-Manche comme «l’enfant terrible des lettres anglaises», celui qui a «redéfini la littérature britannique des années 1980 et 1990 avec des romans au style sombre et mordant», dixit Le Monde. Selon son grand ami Salman Rushdie, précise le quotidien, « c’est un styliste de tout premier plan, très reconnaissable, comme Oscar Wilde, avec un ton sarcastique qui n’appartient qu’à lui ».
«L’enfant terrible des lettres anglaises» a beaucoup cultivé sa réputation de dandy sulfureux dans sa jeunesse et de provocateur sans pitié dans ses chroniques littéraires, ses romans ou ses nouvelles. Mais il s’est aussi révélé d’une profondeur rare dans «Expérience», son autobiographie publiée en 2000, à cinquante et un ans, magnifique porte d’entrée sur l’homme et son œuvre. Pas question pour lui de suivre platement l’ordre chronologique : il revient sans cesse sur certains événements, souvenirs, opinions et obsessions à coup de digressions, en creusant toujours plus, en nous en révélant chaque fois un nouvel aspect. Ce qui donne une œuvre touffue mais bourrée d’humour. Il s’en explique page 279, lorsqu’il est allé à la rencontre de l’immense Saul Bellow (prix Nobel 1976, quatre mariages) à Chicago, «pendant la quatrième semaine du mois d’octobre 1983». Après avoir fustigé la mode de «l’autobiographie suprême» dans la littérature occidentale, voici ce qu’il dit de Saul Bellow : «Son expérience vécue étant avant tout, non pas une affaire de divorces et de querelles politico-littéraires, mais l’histoire de l’émigré et, plus généralement, de l’âme qui dure à jamais dans son décor moderne.»
Car «Expérience», publié à cinquante-et-un ans, ne l’oublions pas, revient sans cesse sur les écrivains qui comptent pour lui plutôt que sur ceux qu’il fustige, à commencer par son propre père, Sir Kingsley Amis, monument de la littérature british, sacré commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) en 1981 et fait chevalier en 1990, pour «services rendus à la littérature» (sic). Dans sa jeunesse, l’insolent Martin ne pardonnait pas à ce père de n’aimer ni Nabokov ni Joyce, deux de ses dieux, mais au fil du livre, l’histoire de leur relation se révèle une des plus belles et complexes relations fils-père qu’on puisse imaginer.
Le livre entier est (vaguement) structuré autour de lettres envoyées de 1967 à 1971 par Martin (alors au «college» puis à l’université d’Oxford) adressées à «Bien chers papa et Jane», Jane étant la romancière Elisabeth Jane Howard, sa belle-mère de 1965 à 1983. Des lettres d’une liberté de ton virtuose. D’autres grands thèmes émaillent les pages, telles ses aventures dentaires dantesques (des dentistes new-yorkais lui arracheront toutes ses dents pour les remplacer par des appareils). Voir page 183 : «Question : combien, parmi ces stylistes remarqués -James Joyce, Vladimir Nabokov, Martin Amis- ont eu à affronter des arrachages de dents catastrophiques au début de la quarantaine ? Réponse: tous les trois.»
Autre grand thème jetant son ombre sur cette puissante autobiographie : l’introduction intitulée «Mes disparues». Sur son bureau, raconte-t-il, un petit cadre à double face contient deux photographies. Celles de Lucy et Delilah. La lycéenne aux longs cheveux est sa cousine germaine adorée Lucy Partington, disparue dans la nuit du 27 décembre 1973 à l’arrêt d’un bus. La famille mettra vingt ans à découvrir qu’elle est tombée entre les mains du tueur en série Frederick West, et ne s’en remettra jamais. Quant à Delilah, «toute petite fille vêtue d’une robe à fleurs sombre…», nous devons attendre la page 436 et ses dix-neuf ans pour assister à leurs retrouvailles fille-père.
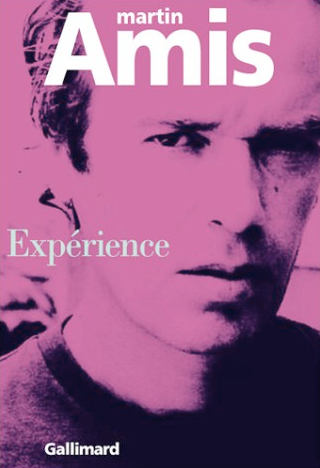 Les quelque cent-cinquante dernières pages sont consacrées à la lente dégradation du «King», son brillantissime père, et à l’évocation de leurs anciennes et incessantes joutes verbales, d’écrivain à écrivain. À la fin, nous dit le fils, il ne reste plus qu’à se réfugier dans les clichés : «Mourir un dimanche : c’était du Kingsley tout craché. Et le dimanche où l’on passe à l’heure d’hiver, en plus : jamais de demi-mesures.»
Les quelque cent-cinquante dernières pages sont consacrées à la lente dégradation du «King», son brillantissime père, et à l’évocation de leurs anciennes et incessantes joutes verbales, d’écrivain à écrivain. À la fin, nous dit le fils, il ne reste plus qu’à se réfugier dans les clichés : «Mourir un dimanche : c’était du Kingsley tout craché. Et le dimanche où l’on passe à l’heure d’hiver, en plus : jamais de demi-mesures.»
Lise Bloch-Morhange


Merci madame Lise, très bon papier »virtuel » …
On attend avec impatience ce film et sa sublime interprète – dont j’ai oublié le nom …-
Cela me donne envie de découvrir Martin Amis.
Ajouté à ma liste de lectures pour cet été ☀️