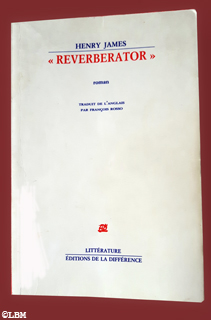 Celles et ceux qui survivent au coronavirus ont de la chance : ils peuvent rester tranquillement chez eux et passer des heures enivrantes en piochant dans leur discothèque et leur bibliothèque privées, à découvrir ou redécouvrir des trésors.
Celles et ceux qui survivent au coronavirus ont de la chance : ils peuvent rester tranquillement chez eux et passer des heures enivrantes en piochant dans leur discothèque et leur bibliothèque privées, à découvrir ou redécouvrir des trésors.
Ce sera peut-être moins facile pour les jeunes générations armées de tablettes et smartphones, chez lesquelles plus un livre, plus un CD, plus un vinyle ne traîne… Mais pour les aînés dont les étagères croulent sous les livres et les CD, quel bain de fraîcheur !
Ainsi, étant comme beaucoup aussi jamesienne que proustienne, j’ai découvert dans ma (très) large section dédiée à Henry James, le Proust américain, un livre que je n’avais jamais lu !
Ce court roman, « Reverberator », date de 1888, et fut d’abord publié en feuilleton dans Macmillan’s Magazine, puis sortit en même temps à Londres et à New York au mois de juin. À quarante-cinq ans, l’auteur de «Daisy Miller», «Washington Square» et «Portrait de femme» (tous des chefs d’œuvre), établi à Londres depuis 1876, connaît une notoriété certaine des deux côtés de l’Atlantique. Mais il se trouve à un moment délicat, car ses deux derniers ouvrages, « The Bostonians » et « La princesse Casamassima », n’ont pas rencontré le succès.
Il faut dire que dans la famille James, on met la barrière assez haut. Le père ayant lui-même été un des plus célèbres intellectuels du milieu du XIXème siècle, le fils ainé William, philosophe et sociologue avant l’heure, un des fondateurs de la psychologie aux États-Unis, a pris la relève, devenant le grand homme de la famille. Bien que n’ayant qu’un an d’écart avec son aîné, Henry subira toute sa vie son poids intellectuel, William ayant tendance à traiter plutôt légèrement les productions de son petit frère, qui ne manquera pas d’enrichir son œuvre de cette complexité familiale.
Or il paraîtrait que l’auguste William ait bien aimé « The Reverberator », « A delightful Parisian bonbon », beaucoup plus léger que les deux livres précédents. Délaissant les thèmes du féminisme et de l’anarchisme, James s’en prend cette fois à la presse mondaine à scandale, en plein essor à l’époque en Amérique. Le titre du roman est le nom de l’une de ces feuilles à ragots, et sur la quatrième de couverture, on nous révèle que l’auteur règlerait ses propres comptes : correspondant du New York Tribune en 1875 et 1876, il aurait été remercié, ses « Lettres de Paris » étant considérées comme trop littéraires et sophistiquées (publiées sous le titre « Esquisses parisiennes », édition La Différence, 1988).
Le pauvre Henry s’empare donc d’un thème qui le touche personnellement, celui de l’évolution de la presse, et de manière prophétique, puisque la multiplication des médias est d’une actualité plus brûlante que jamais.
Comme toujours avec le très subtil Proust américain, tout se passe à plusieurs niveaux, et comme dans la plupart de ses romans et nouvelles, nous voilà en présence d’Américains établis en Europe (comme lui-même), à Paris en l’occurrence.
Le premier groupe d’Américains est constitué d’un certain Mr Dosson avec ses deux filles, de passage à Paris. Le père ne vit que pour et par elles. Totalement soumis à leurs désirs, il est richissime, forcément richissime, mais en toute modestie. L’aînée, Delia, est le cerveau des trois, la seconde, Francina ou Miss Francie, est « extrêmement, extraordinairement jolie », quoique totalement inconsciente de sa beauté et parfaitement soumise à son aînée.
Dans la cour de l’Hôtel de l’Univers et de Cheltenham, déboule par une belle après- midi un certain George Flack (dont le nom sonne comme une claque), qui réclame Francie. On apprend qu’ils se sont tous rencontrés au cours de la traversée d’Ouest en Est, qu’ils se sont retrouvés en Italie, et que le jeune homme travaille pour un nouveau journal yankee, « The Reverberator », pour lequel il « essaie d’apporter aux gens ce qu’ils veulent. » « C’est un dur travail », précise-t-il à Delia. Ah les formules jamesiennes…
Flack propose aux deux sœurs d’être leur nouveau guide dans ce Paris qu’ils connaissent d’ailleurs tous déjà, et devient leur cicerone attitré. Un cicerone brillant, envahissant, plein d’initiatives qu’elles suivent en toute confiance, en jeunes américaines sans préjugés. Décidant un jour que Francie devait avoir son portrait, il les conduit chez un jeune peintre Américain « au talent extraordinaire », « un impressionniste en pleine ascension », Charles Waterlow. Ensuite, il vantera le chef d’œuvre dans les colonnes de son journal.
Dans l’atelier, avenue de Villiers, les sœurs vont faire connaissance du meilleur ami du jeune peintre, Gaston Probert. Ce dernier illustre et personnifie l’autre groupe d’Américains opposé aux trois « exemplaires » de l’Hôtel de l’Univers : il est le descendant d’une riche famille d’Américains installée depuis deux générations en France, devenue de purs représentants proustiens du Faubourg Saint-Germain.
Or un jour, durant une promenade au bois, Flack, se jetant sur Francie telle une proie innocente et consentante, lui soutire tous les petits secrets soigneusement enfouis, plus ou moins reluisants, des marquis, baronnes et autres comtesses de l’illustre famille. L’article va faire plus que scandale, et anéantir au dernier degré les Probert, ainsi que les projets de mariage Francie-Gaston.
Pourquoi Francie a-t-elle éprouvé le besoin de faire ces confidences au journaliste du « Reverberator » ? Flack a-t-préparé son coup pour torpiller le mariage projeté, et pouvoir épouser Francie qui l’a rejeté ?
C’est là qu’intervient le génie jamesien, à plusieurs titres.
Il sait nous faire vivre les affres de ses personnages d’une manière aussi haletante que dans une intrigue policière, passant sans cesse de l’un à l’autre, nous faisant partager leurs affres, changeant ainsi constamment de point de vue jusqu’au vertige.
Et bien entendu, on en revient à un des grands thèmes jamesiens présent à travers toute son œuvre, à savoir celui des Américains confrontés à l’Europe, se montrant d’ailleurs à l’égard des Yankees francisés encore plus sévère que Proust lui-même vis-à-vis du Faubourg Saint-Germain.
Outre cette opposition entre le nouveau et l’ancien continent, l’Ancien et le Nouveau monde, on retrouve également un des autres points forts jamesiens, ou comment les circonstances révèlent les ressources les plus profondes des protagonistes. Francie, l’archétype de la jeune américaine candide, crédule, intellectuellement honnête et ouverte, parviendra-t-elle à faire comprendre ses motivations à Robert ? Celui-ci parviendra-t-il à s’arracher à sa pesante famille ?
Soyons optimistes, puisque Henry James a choisi de traiter ce « délicieux bonbon parisien » d’une plume légère et ironique.
Lise Bloch-Morhange
– «Reverberator», Éditions de la Différence, 1988
– Vient de paraître : « Voyages d’une vie. Heures anglaises. Heures italiennes. La Scène américaine ». Robert Laffont, « Bouquins », 2020
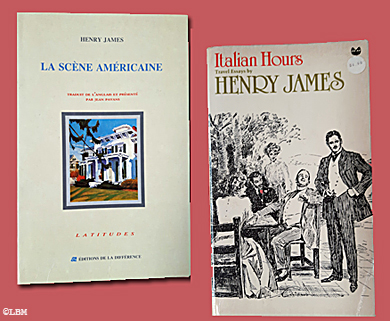


Vous êtes cruelle, chère Lise, avec cet article qui donne terriblement envie de lire ce roman de James que, j’avoue, ne point connaître alors que j’ai lu pas mal de ses ouvrages. Comment pouvoir se le procurer sans librairies, sans bibliothèques et en ces temps où l’on ne sait pas encore si la poste pourra livrer les livres commandés !
Je vous promets qu’à la « Libération », la première chose que je vais faire sera de trouver Reverberator et de lire en terrasse…
Peut-être devrions-nous déjà dresser, comme disait l’autre , »la liste de nos envies » quand ce qui commence aujourd’hui aura pris fin ?
Courage, chère Lise ! je suppose que vous avez assez de disques (ou CD), de films (ou DVD) et de livres pour un confinement de qualité !
Tout comme Marie, cher Philippe,
je suis sûre que vous avez des trésors chez vous dont vous pourriez nous faire profiter.
Mais je comprends votre impatience concernant « Reverberator », et je viens de vérifier: il semblerait qu’Amazon, par exemple, assure maintenant 20 à 30 % de ses envois elle-même.
Mais serait-ce un « envoi essentiel » ou un « besoin naturel » alors que nous sommes en temps de « guerre », comme l’a répété six fois Mister President sans employer une seule fois le mot de confinement?
Profitons des circonstances pour relire nos classiques!
Mais, Philippe, n’avez-vous pas, comme Lise une pépite cachée dans votre bibliothèque que, comme Lise, en ces temps de disette théâtrale et cinématographique, vous pourriez nous faire partager ?