 Le 26 novembre dernier, à Fontainebleau, s’est éteint Yves Delange, grand naturaliste et botaniste français. Il fut l’un des plus ardents défenseurs du Jardin botanique des Serres d’Auteuil. Pendant les quelque huit années que dura notre combat contre la fédération de tennis et les gouvernements successifs rameutés non stop par Delanoë puis Hidalgo, il a toujours réagi au quart de tour pour solliciter ses contacts ou rédiger à l’instant un texte savant mais très concret. En homme aussi savant que modeste, disponible et chaleureux. Autant dire en homme d’un autre temps.
Le 26 novembre dernier, à Fontainebleau, s’est éteint Yves Delange, grand naturaliste et botaniste français. Il fut l’un des plus ardents défenseurs du Jardin botanique des Serres d’Auteuil. Pendant les quelque huit années que dura notre combat contre la fédération de tennis et les gouvernements successifs rameutés non stop par Delanoë puis Hidalgo, il a toujours réagi au quart de tour pour solliciter ses contacts ou rédiger à l’instant un texte savant mais très concret. En homme aussi savant que modeste, disponible et chaleureux. Autant dire en homme d’un autre temps.
Il est vrai qu’il mesurait, plus que tout autre, le gâchis que représenterait l’amputation et la bétonisation de l’un des plus beaux jardins de Paris, riche de serres chaudes contenant un trésor mondial de quelque dix-mille plantes tropicales. De plus, dans l’ouvrage « La belle histoire illustrée des arbres de Paris », publié en collaboration avec sa femme Chansocthony aux éditions Alzieu en 2012, il y avait recensé quelque soixante-dix « beaux arbres » (ou arbres rares).
Sa passion des plantes et des arbres datait de ses émerveillements de petit garçon grandissant dans le jardin paternel prolongeant la modeste maison bâtie l’année de sa naissance, le 26 mai 1929, sur les hauteurs périphériques de Rouen, « la ville aux cent clochers ».
Il a raconté dans « D’ombre et de lumière, évocations autobiographiques d’un naturaliste » (Éditions L’Harmattan, 2014), les ivresses que lui procurait en particulier le buddleia, petit arbre importé de Chine aux longues panicules mauves très appréciées des abeilles et autres hyménoptères, sans oublier les papillons comme « le paon du jour », « la vanesse vulcain » ou « le grand porte-queue ».
La « ville aux cent clochers » possédant également un des plus importants muséums de France, le jeune Yves devint, dès l’âge de quatorze ans, membre de la Société des Amis du Muséum. Sa vocation était toute trouvée, et avant même de passer le bac, il fila à l’École nationale supérieure de Versailles, installée depuis sa création au XIXème siècle dans le Potager du Roi.
Là il vécut de fleurs et d’eau fraîche, mais aussi de musique aux Jeunesses musicales de France (JMF) à Paris.
Mais depuis qu’il avait lu tout jeune les écrits de l’illustre entomologiste Jean-Henri Fabre (sous-estimé en France), l’étudiant rouennais ne souhaitait qu’une chose, rejoindre les terres du Midi, leur soleil, leur flore et leur faune. Au début du mois d’octobre 1953, il prit donc la direction du premier jardin botanique de France, celui de Montpellier, créé par le sieur Pierre Richier de Belleval sous Henri IV. Là, au lieu-dit « la Montagne », dans le Jardin des Plantes, il découvrit notamment l’olivier datant d’Henri IV, et bien d’autres lieux de mémoire végétaux qu’il fallait faire revivre de fond en comble. Les Allemands, notamment, ayant piétiné les lieux.
Un travail énorme avec très peu de moyens dans ce qui ressemblait « à un vieux parc abandonné », mais avec les encouragements d’un chat qui l’avait adopté. Bien loin de se faire mousser, Yves Delange souligne dans son livre autobiographique la modestie des moyens, le travail de fourmi nécessaire, les luttes contre les novateurs à la Le Corbusier qui voulaient tout bétonner, à la Ville comme au Jardin (déclaré enfin monument historique en 1992, mais cette protection n’a pas sauvé les Serres d’Auteuil…).
Avant de pouvoir tout réaménager, note-t-il en passant, il dut subir une opération cérébrale pionnière de la dernière chance, alors qu’il se trouvait dans le coma : il fallut cinq heures au neurochirurgien pour extraire de son lobe temporal gauche un abcès de la taille d’une orange.
Chétif depuis l’enfance et miraculé à vingt-six ans, rien ne devait entamer son désir de poursuivre sa passion, incarnée dans une brillante carrière. Après dix-huit années à Montpellier, malgré l’obligation de s’éloigner du soleil, comment aurait-il pu résister au Graal, le Museum national d’histoire naturelle de Paris, second pôle de la vie botanique française ?
C’était un bien grand privilège d’habiter ce jardin, m’a-t-il dit, un privilège qui allait durer un quart de siècle. Juste sous les fenêtres de sa maison-bureau, s’élevait un érable de Montpellier…
Et pendant ce temps-là, il devint passionné de plantes tropicales, effectuant pour le muséum de nombreux voyages aussi bien en Crète, en Afrique australe, en Namibie, en Égypte, aux Antilles et au Mexique. Il a publié plusieurs centaines d’articles scientifiques et de vulgarisation, et une vingtaine de livres dont la biographie de J.B. Lamarck et J.H. Fabre, ainsi qu’un « Plaidoyer pour les sciences naturelles » en 2009 chez L’Harmattan.
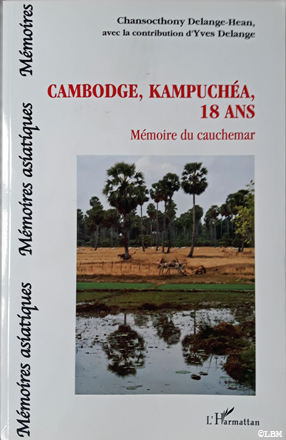 Deux jours avant sa mort, m’a raconté sa femme la cambodgienne Chansoctony Hean, il se réjouissait de la parution imminente de leur dernier ouvrage commun chez L’Harmattan: le terrible exode de Chansoctony, de ses parents, et de ses cinq sœurs et quatre frères, fuyant l’arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh.
Deux jours avant sa mort, m’a raconté sa femme la cambodgienne Chansoctony Hean, il se réjouissait de la parution imminente de leur dernier ouvrage commun chez L’Harmattan: le terrible exode de Chansoctony, de ses parents, et de ses cinq sœurs et quatre frères, fuyant l’arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh.
En fait le livre est la mise en forme par Yves du récit de sa femme, il est donc très proche du langage parlé. L’ouvrage s’intitule « Cambodge, Kampuchea, 18 ans – Mémoire du cauchemar ». Kampuchéa étant le nom officiel du Cambodge sous ces fanatiques qui le dominèrent par la répression et le sang de 1975 à 1979.
Après avoir évoqué en quelques pages son enfance heureuse de cinquième fille de famille nombreuse avec un père fonctionnaire des Eaux et Forêts qui les initie aux mystères de la nature, elle évoque ce 17 avril 1975, douze jours avant ses dix-huit ans, début de ce qu’elle appelle « l’exode » ou « la déportation ».
Bien sûr, pour nous, en Europe, le terme de déportation revêt un caractère spécial, mais les conditions seront telles que cette famille (et des millions de Cambodgiens) va vivre ces cinq années avec le sentiment d’être déportée.
Chansocthony décrit d’abord chaque minute, chaque heure des trois premiers jours, puis des jours, des mois, des années, avec un luxe de détails et de souvenirs de chaque instant, d’horreurs quotidiennes et de sentiment permanent de mort imminente.
Ils ne savent jamais ce que l’heure suivante leur réserve, ne peuvent qu’essayer de survivre au jour le jour, passeront six mois à Sampann, puis arriveront à Kampong Thom, puis séjourneront huit mois à Pnom Deik, puis nouveau départ, etc.
L’obsession est de trouver chaque jour assez de riz pour nourrir toute la famille. Pour y parvenir, chaque membre de la famille travaille dans des conditions inhumaines. Et c’est finalement leur jeunesse et leur nombre qui leur permettront d’en sortir vivants (mais pas les grands-parents).
Il est beau qu’Yves Delange ait mené à bien ce travail avec sa femme juste avant de disparaître.
Lise Bloch-Morhange
« Cambodge, Kampuchea, 18 ans. Mémoire du cauchemar », Chansocthony Delange-Hean, avec la contribution d’Yves Delange, L’Harmattan.


Franchement, un très bel article !
Chère Lise, pour compléter le livre de Madame Delange, je recommande la vision du très beau documentaire de Davy Chou, « Le Sommeil d’or »… Là, ce ne sont pas des arbres qui ont disparu sous les tronçonneuses barbares mais des films… En effet, les Khmers rouges n’ont pas que massacré des hommes, ils ont détruit le cinéma cambodgien. Jusqu’en 1975, les Cambodgiens produisaient des films très populaires ancrés souvent sur les contes et légendes du pays. Des quelques affiches qu’il en reste et du souvenir de ceux qui les ont vu avant 1975, leur climat était féérique. On y racontait de belles et naïves histoires d’amur. Outre les films, ont péri presque tous les cinéastes les ayant fabriqué. Peu de comédiens ont pu également survivre. Quant aux salles, dont certaines étaient richement décorées, aucune n’a été épargnée.
Des dizaines de films morts à tout jamais puisqu’ils n’étaient qu’à destination interne. Un cas unique de « cinématicide »…
Vous en savez, des choses, chez Philippe!
Je veux dire: Vous en savez des choses, cher Philippe!