 Tel est le titre du dernier livre de Michel Schneider, essayiste et psychanalyste, dans lequel il nous propose une douzaine d’essais sur de grands écrivains, dont huit déjà publiés mais « amendés », et cinq inédits. Un nouveau témoignage, comme les précédents (voir notamment ses « Morts imaginaires »), de sa folle passion pour la littérature, et de son style remarquable et percutant.
Tel est le titre du dernier livre de Michel Schneider, essayiste et psychanalyste, dans lequel il nous propose une douzaine d’essais sur de grands écrivains, dont huit déjà publiés mais « amendés », et cinq inédits. Un nouveau témoignage, comme les précédents (voir notamment ses « Morts imaginaires »), de sa folle passion pour la littérature, et de son style remarquable et percutant.
Le premier et bref essai, « Personne d’autre », s’ouvre sur une citation d’une nouvelle de Henry James « The birthplace » (La maison natale). James y raconte comment un couple de petits bibliothécaires d’âge moyen se voit offrir une nouvelle et prestigieuse situation, en devenant les guides de la maison natale d’un fameux auteur, mort depuis des siècles. Ils vont habiter la maison du gardien, et la femme se coulera avec délices dans l’ombre du grand homme, en répétant aux foules béates l’argumentaire mis au point, tandis que le mari, Morris Gedge, va peu à peu (comme toujours chez James !) être saisi d’un certain écœurement devant l’avidité des visiteurs, et tout remettre en question. Jusqu’à se demander si le grand homme est vraiment né là. James lui répond, et c’est la citation qui ouvre ce chapitre introductif: « L’œuvre est la chose. Laissons l’auteur tranquille. (…) il n’y a aucun auteur ; il faut nous y faire. Il y a tous les personnages immortels – dans l’œuvre. Mais il n’y a personne d’autre. »
Autrement dit, le livre pose d’emblée cette éternelle question débattue par Proust dans son « Contre Sainte-Beuve », celle de savoir si la personnalité et la vie d’un écrivain peuvent éclairer son œuvre, à laquelle Proust a répondu comme James : seuls comptent l’œuvre et ses personnages.
Aussitôt, Schneider enchaîne ainsi : « On peut visiter à Prague, dans le château, au 22, ruelle d’Or, la maison de Kafka. Là, il aurait écrit Le Château, mais parmi les serviettes et carpettes récapitulant les femmes de sa vie, les t-shirts siglés Métamorphose et les mugs à l’effigie de l’auteur, on repense à ce qu’écrivait le pauvre Franz : « Quand on écrit, il n’y a jamais de silence autour de vous, la nuit est encore trop peu la nuit. » D’où le titre du livre.
Mais contredisant sa position initiale, l’essayiste nous fait vivre dans l’essai suivant, « Le cri de la souris Franz Kafka. », les derniers jours de l’écrivain, nous apprenant notamment comment « défiant la mort et la folie », il s’acharne sur son dernier récit, Joséphine, la cantatrice, pour lequel il avait « commencé à temps à étudier le cri de la souris ». Sic !
Pour les deux essais suivants, consacrés à Elias Canetti puis Robert Musil, il faut avoir en tête leur première date de publication, 1981 et 1982. Schneider sentait alors le besoin de défendre vigoureusement leur œuvre, alors qu’aujourd’hui, il semblerait qu’ils soient davantage reconnus. Notons aussi page 69 cette phrase: « Je n’ai pas l’intention de tirer malgré lui Canetti vers la psychanalyse », une phrase qui peut faire sourire, venant d’un psychanalyste. Cela dit, lorsqu’il dévoile dans l’essai intitulé « La langue sauvée Elias Canetti » l’origine de cette « langue sauvée », on peut comprendre qu’elle puisse relever d’une lecture de ce genre.
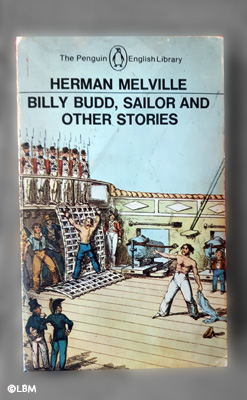 Par contre, il m’a semblé un peu étonnant (mais je ne suis pas psychanalyste !) de tirer à ce point vers la psychanalyse l’extraordinaire nouvelle « Bartleby », dans l’essai intitulé « Lettres mortes Herman Melville ». Melville est cet écrivain américain né à New York City en 1819, qui connut une célébrité immédiate, à trente-et-un ans, avec la publication de « Moby Dick », célébrité suivie d’un tenace anonymat attaché à ses nouvelles suivantes.
Par contre, il m’a semblé un peu étonnant (mais je ne suis pas psychanalyste !) de tirer à ce point vers la psychanalyse l’extraordinaire nouvelle « Bartleby », dans l’essai intitulé « Lettres mortes Herman Melville ». Melville est cet écrivain américain né à New York City en 1819, qui connut une célébrité immédiate, à trente-et-un ans, avec la publication de « Moby Dick », célébrité suivie d’un tenace anonymat attaché à ses nouvelles suivantes.
Employé modèle chez un homme de loi de Wall Street, Bartleby, a scrivener, un copiste, se contente de copier à longueur de journée des actes légaux. Mais le jour où son patron lui demande de faire une double lecture en confrontant son travail à l’original, l’humble copiste lui répond :
« I would prefer not to ». Je préfèrerais ne pas. Je préfèrerais ne pas le faire.
Très étrange formule, devenue célèbre dans la littérature américaine, qui va plonger le patron de Bartleby dans la perplexité la plus totale. Car le clerc refuse de s’expliquer, et se contente de répéter cette « profession de foi », y compris devant toute autre demande de son patron, qui va progressivement perdre tous ses repères face à cet homme insondable qui les a déjà perdus.
Les deux hommes vont alors se livrer un duel à mort finement analysé par Michel Schneider, faisant d’abord du patron, sur le plan symbolique, l’analyste de Bartleby, puis renversant les rôles. Il y voit l’impossible cure analytique d’un fou, car si les névrosés peuvent être guéris par la parole, ce n’est pas le cas, dit-il, des psychotiques et des fous.
Mais que voulait dire Melville, en créant ce personnage unique dans toute la littérature ? Bartleby est-il un fantôme, un saint ou un fou surgi de son inconscient ? Mais quelle sorte de fou ? Il faut attendre la toute fin du chapitre pour savoir pourquoi l’auteur intitule cet essai « Lettres mortes ».
Dans l’essai inédit consacré à Flaubert, « La vie est bête », Schneider s’attache à déchiffrer le rapport de l’écrivain à la femme et à l’amour, révélé à travers le thème de la prostitution qui irrigue son œuvre et sa correspondance: « Envers de l’amour, elle en est peut-être aussi l’idéal ».
Nous assistons à la « scène initiale » de « L’éducation sentimentale », celle où Frédéric Moreau rencontre Marie Arnoux. « Ce fut comme une apparition », écrit Flaubert. Nous sommes alors renvoyés à une autre apparition, celle de la très belle danseuse et prostituée Kuchiuk-Hanem entrevue par Flaubert à Esneh, au bord du Nil, le 6 mars 1850, qui figure dans sa correspondance : «Tout revient de la scène de 1850 dans le roman écrit en 1865». Tout comme revient, dans la vie de Flaubert, l’incapacité à réconcilier les deux types de femme : «Tu es bien la seule femme que j’ai aimée et que j’ai eue, écrit-il à Louise Collet. Jusqu’alors, j’allais calmer sur d’autres les désirs donnés par d’autres. »
Ainsi Frédéric Moreau allant au bordel avec un beau bouquet de fleurs à la main « comme chez une bourgeoise », et croyant –voyant- qu’on se moque de lui, s’enfuit en se trouvant « bête », dit Schneider, qui précise plus loin : « Flaubert avait la bêtise malheureuse. » Écrire, ne pas écrire, les femmes, les amitiés, « tout l’embête ».
Dans « L’ombre de l’auteur Charles Baudelaire », Michel Schneider traite de la question du plagiat littéraire, essentiellement à partir de la relation de Baudelaire avec Edgar Poe. On sait que le poète a traduit les « Histoires extraordinaires » de Poe, écrivain américain né à Boston en 1809, considéré comme l’un des pionniers du roman policier (notamment dans ses nouvelles « Double assassinat dans la rue Morgue » ou « La lettre volée »). Mais ce qui intéresse notre essayiste est l’extraordinaire identification du poète à l’écrivain américain, « au point de ne plus faire le départ entre ce qui était de lui et ce qui venait de l’autre », et de le plagier, inconsciemment ou pas.
Ce qui, par extension, pose la question de l’ombre des grands anciens planant sur celui qui veut devenir lui-même auteur. « On ne parle jamais avec ses mots à soi, nous dit Schneider, nos propres mots ne sont que le résultat d’une appropriation. Parler, écrire, c’est plagier. » Ce qui n’est pas sans rappeler le brillant livre de Pierre Bayard « Le plagiat par anticipation » (Les éditions de Minuit)(voir mon article Pierre Bayard l’annonce, Le Titanic fera naufrage, 12 janvier 2017).
L’essayiste entreprend en outre de nous entretenir de Chateaubriand, Platon, Jean Starobinski, son maître, et Malraux, à travers lequel il traite du désir d’immortalité des écrivains, concluant par cette phrase : « Ce qui reste peut-être de Malraux, c’est sa folie d’écrire. »
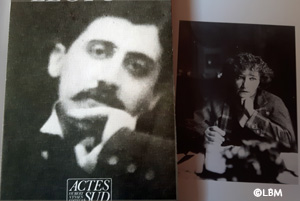 Il se plaît aussi à rapprocher (plutôt que comparer) Colette et Proust dans « Les affinités sélectives », procédant ainsi : Colette avant Proust, Colette avec Proust, Colette contre Proust, Colette comme Proust.
Il se plaît aussi à rapprocher (plutôt que comparer) Colette et Proust dans « Les affinités sélectives », procédant ainsi : Colette avant Proust, Colette avec Proust, Colette contre Proust, Colette comme Proust.
Pour qui aime ces deux écrivains, c’est un délice de suivre les méandres de leur relation et de la reconnaissance mutuelle de leur talent unique. A propos du commentaire de Colette sur « Du côté de chez Swann », Michel Schneider s’écrie : « Que peut dire de plus beau un écrivain à propos d’un autre : « Il a écrit ce que je n’aurais pu écrire» ? Notons enfin cette réflexion, en passant : «( … même s’il m’arrive parfois, je l’avoue, de penser que Colette, moins grand écrivain que Proust, écrit mieux que lui) ».
Lise Bloch-Morhange
« Écrit dans le noir » Essais sur la littérature Michel Schneider, Buchet Chastel


Voilà un rendez-vous littéraire que je me délecterai de prendre… Merci Lise