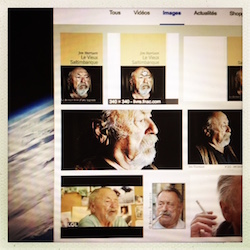 Jim Harrison s’en est donc allé… Une triste nouvelle qui vint obscurcir l’orée d’un printemps 2016. On ne verra donc plus cette silhouette massive claudiquer dans les rues de Paris, en quête de beau, de bon, armé d’une canne tenant plus du gourdin. Il aimait la France et elle le lui rendait bien. Même si ces dernières années sa production n’avait plus la puissance littéraire d’un « Dalva » qui l’avait sacré de ce côté de l’Atlantique monument de la littérature américaine. Chacun de ses passages promotionnels dans la capitale étanchait chez lui sa fringale de vins et de bouffes et achevait au fil d’interviews dont il n’était pas avare de nous régaler de cet esprit libre, drôle et lucide faisant souffler l’air toujours frais du Michigan sur Saint Germain des Prés.
Jim Harrison s’en est donc allé… Une triste nouvelle qui vint obscurcir l’orée d’un printemps 2016. On ne verra donc plus cette silhouette massive claudiquer dans les rues de Paris, en quête de beau, de bon, armé d’une canne tenant plus du gourdin. Il aimait la France et elle le lui rendait bien. Même si ces dernières années sa production n’avait plus la puissance littéraire d’un « Dalva » qui l’avait sacré de ce côté de l’Atlantique monument de la littérature américaine. Chacun de ses passages promotionnels dans la capitale étanchait chez lui sa fringale de vins et de bouffes et achevait au fil d’interviews dont il n’était pas avare de nous régaler de cet esprit libre, drôle et lucide faisant souffler l’air toujours frais du Michigan sur Saint Germain des Prés.
Comme un clin d’œil, et de la part d’un borgne ça ne se refuse pas, il laisse derrière lui un ultime cadeau à ceux qui ont aimé le suivre dans ses errances qui furent celles d’un homme jonction entre le vieux monde, celui de sa chère nature, et le moderne qu’il n’a fait qu’arpenter en marge, fidèle à ses obsessions comme un vieux de chien de chasse l’est à son maître.
Alors c’est parti pour une dernière balade avec Jim.
D’abord cette incongruité… Pour la première fois, il nous parle à la troisième personne. Comme s’il n’était déjà plus là ? Peut-être… une chose est sûre, ce « Il » s’oublie dès les premières pages tant il est clair que c’est Jim qui nous parle. Le vieil animal rusé, utilise ce « il » pour contrer sans doute quelques esprits chagrins mais lucides qui pourraient trouver en ce « Vieux saltimbanque », un digest paresseux de son parfait « En marge », journal massif et intime paru en 2002. Peu importe ! Et ce serait mal le jauger que d’y voir une quelconque paresse. Ecrire est chez lui physique, éreintant, exigeant. Ce livre n’y échappe pas.
Cet écrivain donnerait tous les scénarios du monde pour un poème. Mais il faut manger et Jim mange beaucoup. Hollywood saura y pourvoir. Les plus beaux passages sont d’ailleurs ici, sur la création littéraire, et la lutte permanente entre l’exigence créatrice et la nécessité matérielle. En fil rouge de cette digression naturelle, il y a aussi sa femme, qui vit depuis des années à-côté de ce dingue, merveilleux menteur, capable de ramener d’un passage en ville une truie de 250 kilos, qui mettra bas une portée de porcelets. Roses et frétillants, ils ramènent Jim à ses souvenirs d’enfance. On y croise aussi d’autres femmes et le constat d’un désir charnel qui s’en est allé au fil des ans. Le Viagra n’y pourra rien. C’est sans artifice en revanche qu’il dit avec pudeur tout l’amour qu’il porte à sa femme et à cette union qui lui a permis de construire cette œuvre.
Ce livre est beau comme une ultime balade avec l’ami d’une vie, la re-visitation sans surprise obligatoire, de tout ce qui nous l’a fait aimer un jour. Ce livre peut être la porte qui mènera les néophytes à l’œuvre de Jim Harisson. Les autres, le refermeront avec un sourire triste, comme quand une belle histoire s’achève.
Philippe Bourbeillon
Jim Harrison « Le Vieux saltimbanque Flammarion » . 148 pages. 15 euros.


Je me souviens d’être tombé sur lui à la Fnac Ternes. ll était seul assis à une table, attendant l’employé qui allait lui mettre en place une pile de livres à signer. Les gens passaient devant lui sans savoir qui c’était… Car dans ces « temples de la consommation culturelle », il faut que tout soit annoncé, genre « attention, écrivain américain universellement connu seul à une table au rayon littérature »…
Je l’ai regardé un instant et j’ai passé mon chemin : ce n’était pas Philip Roth… Alors…
Je me souviens, moi, d’avoir fait la queue, il y a une vingtaine d’années, dans une librairie du Faubourg-Saint-Antoine pour faire dédicacer un de ses ouvrages. Je n’avais pas bien compris ce qu’il m’avait dit et qu’il avait conclu par un éclat de rire mais je n’oublierai pas son regard, qui m’avait tout à fait percée à jour…
Je me souviens pour ma part avoir fait le voyage du sud de la France jusqu’à Fontainebleau pour le rencontrer et d’avoir parlé avec lui de … »cuisine-minceur »!
Il n’avait jamais entendu parler de la ville de Narbonne d’où je venais, mais il l’a notée et l’année suivante, il la mentionna dans une de ses nouvelles. J’ai imaginé qu’il avait voulu m’adresser un clin d’œil de l’autre côté de l’Atlantique et après l’avoir lue, j’ai trinqué de loin avec lui.
J’aime bien l’idée de « l’air du Michigan » soufflant sur dt Germain des Prés ». S.