 Magnifique rentrée musicale parisienne, au cours du premier week-end de septembre, lors du festival Solistes à Bagatelle. Le temps avait viré au gris et les somptueux arbres du parc étaient quelque peu chahutés par le vent, mais cela n’avait pas découragé les fidèles venus écouter un pianiste rare, Philippe Bianconi, pianiste rare par le talent et par la présence.
Magnifique rentrée musicale parisienne, au cours du premier week-end de septembre, lors du festival Solistes à Bagatelle. Le temps avait viré au gris et les somptueux arbres du parc étaient quelque peu chahutés par le vent, mais cela n’avait pas découragé les fidèles venus écouter un pianiste rare, Philippe Bianconi, pianiste rare par le talent et par la présence.
Il a fallu du temps pour que les Français reconnaissent cet artiste longtemps plus connu à l’étranger que dans son pays. En partie parce que ce « jeune pianiste niçois » était pratiquement directement passé de sa ville natale à l’étranger, remportant le premier prix du Concours International Robert Casadesus à Cleveland (Ohio) en 1981 (à vingt-et-un ans), puis la médaille d’argent du Concours International Van Cliburn (Texas) en 1985. Ce qui lui valut, dit-on, d’être acclamé lors de son premier grand récital au Carnegie Hall de New York en 1987.
Pas mal pour un « jeune pianiste niçois » désormais demandé aussi bien en Amérique qu’au Japon ou en Australie, et sur de grandes scènes européennes mais guère françaises. Et qui eut le bonheur de travailler avec des chefs d’orchestres tels que Lorin Maazel, Kurt Masur, Christoph von Dohnanyi, Georges Prêtre, Michel Plasson, James Conlon, Marek Janowski, etc, etc.
Un pareil destin aurait pu lui tourner la tête et l’amener à jouer le jeu ( dans tous les sens du terme ) de la célébrité, mais ce n’est pas du tout son tempérament. En dépit de si beaux débuts, il avait besoin de murir et d’apprendre à se livrer face au public, ce qui demande du temps. Il a pris son temps, et appris à établir un contact particulièrement chaleureux, comme on a pu le voir dimanche 4 septembre dans l’Orangerie de Bagatelle (gardant son sourire et sa concentration malgré deux interruptions stridentes du système de sécurité). L’authenticité de sa présence et de son sourire reflète celle de son jeu, virtuose sans esbroufe, à l’écoute du compositeur mais venu du fond de sa sensibilité.
Après nous avoir régalés de toutes les couleurs du Carnaval de Schumann, puis d’une brève pièce contemporaine signée Alain Louvier, nous avons entendu, en final, trois célèbres extraits des Miroirs de Maurice Ravel : Oiseaux tristes, Une barque sur l’océan et Alborada del Gacioso, nous transportant des jeux infinis des vagues sous la lumière aux mille trépidations de l’Espagne.
Ce qui m’a rappelé la véritable odyssée qu’il nous avait offerte en 2013 au théâtre de l’Athénée en interprétant l’intégrale des Préludes de Debussy, qu’il venait d’enregistrer. «Je vous remercie de m’avoir accompagné dans ce difficile, mais merveilleux voyage», avait-il déclaré à la fin, nous ayant tenus envoutés tout du long du bout de ses doigts, hors du monde, même pour quelqu’un comme moi qui n’est pas la plus ardente des debussystes !
Il ne faut pas manquer sa prochaine prestation parisienne à Gaveau le 6 décembre, et repérer ses divers concerts à venir en France sur son site (www.philippebianconi.com).

Photo: LBM
Après deux CD consacrés à Debussy et Chopin il vient de sortir un Schumann (toujours chez La Dolce Volta), que je vais découvrir. A propos de ce dernier, je suis encore sous le choc de la lecture du petit livre de Nicolas Cavaillès (éditeur de Cioran dans la Pléiade) intitulé « Les huit enfants Schumann », paru aux éditions Le Sonneur. L’auteur consacre un chapitre à chacun des enfants Schumann, dont le sort fut aussi chaotique que celui de leur père Robert ou de leur mère Clara, le génie en moins pourrait-on dire.
En fait leur destin fut plus ou moins apocalyptique : une fois leur père retiré à l’asile pour divers troubles (syphilitiques semble-t-il) en 1854, Clara refusa de le reprendre à la maison quand il allait mieux, reprit ses tournées pianistiques, et se comporta vis-à-vis de ses enfants avec une dureté et une insensibilité à peine croyable. C’est en tout cas le tableau esquissé par l’auteur, qui brosse de Clara le portrait d’une mère monstrueuse sur un ton très personnel et singulier qui vous empoigne, comme si cette sorte de malédiction s’attachant à chacun de ces enfants le touchait personnellement.
Si nous sommes habitués au thème de la « malédiction » s’attachant aux grands musiciens (Mozart mort « dans la misère » à 35 ans, Chopin mort à 39 ans « délaissé par George Sand », Schubert mort à 31 ans, etc, etc), nous découvrons là comme sa prolongation inédite. S’il ne fait pas bon être un grand créateur, il ne fait pas bon être l’enfant de Clara Schumann, écrasant toute velléité de leur part de se faire un prénom.
Et il ne fut pas bon non plus être Dimitri Chostakovitch, si l’on en croit le dernier « roman » de Julian Barnes, le plus francophile des écrivains anglais depuis la parution de son fameux « Perroquet de Flaubert ». Si Nicholas Cavaillès s’est attaché au tragique destin de huit enfants d’un génie musical du dix-neuvième siècle, Julian Barnes, dans son ouvrage intitulé « Le fracas du temps », se demande comment un grand créateur, un grand musicien, a pu créer et survivre dans la Russie du vingtième siècle.
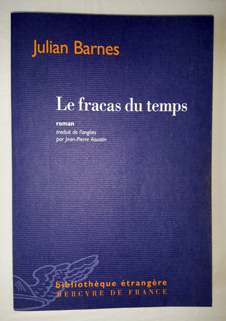
Photo: LBM
On sait que Chostakovitch fut tour à tour adulé puis ostracisé par le régime, et l’écrivain, se mettant dans la peau du musicien et s’exprimant par sa bouche, a construit son livre en trois parties, trois moments clefs de sa vie de créateur :
« Sur le palier », lorsqu’il attend en 1936, dans le couloir de son appartement, valise à la main, au milieu de la nuit, au pied de l’ascenseur, qu’on vienne le conduire en prison; « Dans l’avion », lorsqu’il revient en 1948 d’un congrès aux Etats-Unis auquel il n’a pas pu échapper et au cours duquel il s’est renié en paroles; « En voiture », vers la fin de sa vie, dans sa voiture avec chauffeur, en route vers sa datcha, se livrant à un bilan désabusé sur sa vie et son œuvre.
Connaissant le talent de Barnes, on peut lui faire confiance pour évoquer des scènes (imaginaires ou non) stupéfiantes vécues par le grand créateur dans une perpétuelle angoisse, aussi angoissé lorsqu’on le porte aux nues que lorsqu’on le piétine. Il s’agit de Chostakovitch, mais ce pourrait être n’importe quel créateur…
Quant à la rentrée musicale à la Maison de Radio France, elle se fera dès les 15 et 16 septembre avec les deux grandes phalanges maison, l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philarmonique de Radio France. Au-delà, notons le Concerto pour violoncelle de Schumann, justement, avec le petit génie du violoncelle Edgar Moreau et le National le 23 septembre (programmé à la Philharmonie). Et toujours avec le National, Les Nuits d’été de Berlioz par l’exemplaire mezzo Anne-Sophie Von Otter le 29 septembre.
A l’autre bout de Paris, la Philharmonie de Paris a déjà commencé sa saison début septembre. Dans le foisonnement des concerts proposés, on aura une pensée pour le livre de Julian Barnes en allant écouter le 20 septembre à 15 heures le Quatuor à cordes n°8 de Chostakovitch.
Lise Bloch-Morhange

