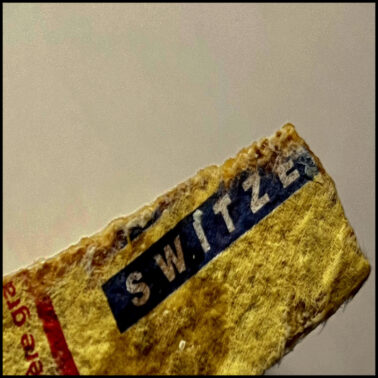 Dans son acception originelle, le terme gruyère désigne un fromage à pâte pressée cuite, présenté en meules d’une quarantaine de kilos, fait de lait de vache, produit dans la région du même nom, dans le canton de Fribourg, en Suisse. L’appellation découlerait, selon certains, du blason des seigneurs de Gruyère, « de gueules à la grue d’argent » (1). Mais il semble que l’on prenne ici l’effet pour la cause. La tradition française, de son côté, fait référence au gruyer, officier public ayant la charge, en droit féodal (2),de percevoir l’impôt sur l’exploitation des forêts et clairières. C’est vraisemblablement la raison de l’oiseau sur le blason, exemple d’armoiries parlantes, celles comportant des figures exprimant plus ou moins le nom du titulaire. Le gruyer percevait-il l’imposition en équivalent fromages, ou se faisait il payer ainsi l’importante quantité de bois nécessaire à la chauffe du lait? Ces deux hypothèses sont tour à tour avancées. Ce ne serait pas la première fois qu’un fromage se retrouve dans un contexte fiscal.
Dans son acception originelle, le terme gruyère désigne un fromage à pâte pressée cuite, présenté en meules d’une quarantaine de kilos, fait de lait de vache, produit dans la région du même nom, dans le canton de Fribourg, en Suisse. L’appellation découlerait, selon certains, du blason des seigneurs de Gruyère, « de gueules à la grue d’argent » (1). Mais il semble que l’on prenne ici l’effet pour la cause. La tradition française, de son côté, fait référence au gruyer, officier public ayant la charge, en droit féodal (2),de percevoir l’impôt sur l’exploitation des forêts et clairières. C’est vraisemblablement la raison de l’oiseau sur le blason, exemple d’armoiries parlantes, celles comportant des figures exprimant plus ou moins le nom du titulaire. Le gruyer percevait-il l’imposition en équivalent fromages, ou se faisait il payer ainsi l’importante quantité de bois nécessaire à la chauffe du lait? Ces deux hypothèses sont tour à tour avancées. Ce ne serait pas la première fois qu’un fromage se retrouve dans un contexte fiscal.
Initialement, le gruyère était fabriqué pendant la période estivale, et valorisé le reste de l’année. Il s’incluait dans une forme d’élevage en contexte montagnard, le bétail étant nourri au fil des saisons, soit d’une herbe à grande richesse florifère, dans les pâtures, soit de foin, à l’étable. La quantité de lait récoltée pour la fabrication d’une meule a conduit à un système de coopérative agricole, les traites du matin et du soir de différentes fermes étant collectées par un fromager fabricant, dénommé « fruitier », puisqu’il assurait le fruit de leur travail. Ses cuves de cuivre pouvaient contenir, en caillé, de quoi confectionner quatorze meules. Celles-ci étaient ensuite confiées à un affineur, à charge pour lui de frotter régulièrement les meules d’une solution saumurée, riche en bactéries et levure. Ainsi se formera une croûte imperméable au sein de laquelle maturera la pâte qui sera consommée. Elles seront conservées en cave humide, entre quatre mois et deux ans.
Le gruyère de stricte obédience, helvétique, est dépourvu de trous, également dénommés « yeux ». On parle alors de « fromage aveugle ». Le gruyère français en présente très peu, de petite taille. Mais tandis que les Suisses tiennent à ce que chacune de leurs spécialités fromagères garde son nom spécifique, les Français sont assez peu regardants. Ils dénomment facilement gruyère le comté, l’abondance, le beaufort… Et pourquoi pas ce fromage industriel, vendu en tranches de couleur jaune plastique, fabriqué n’importe où, au goût quelconque, fenêtré de trous de taille variable, dont on fait le râpé de consommation courante. Et précisément, ces trous lui donnent également le nom d’emmental.
Il existe effectivement un fromage dénommé emmentaler, provenant de la vallée de l’Emme (tal signifiant vallée, en allemand), située à l’est du canton de Berne. Il est de la même famille que le gruyère, sa fabrication suit un cahier des charges similaire, et comme lui, est le seul détenteur de l’AOC. Toutefois ses meules pèsent, elles, près de quatre-vingt-dix kilos. Au XIXe siècle, les droits de douane affectant cette spécialité étaient déterminés non sur le poids mais le nombre de pièces exportées. Différence majeure entre gruyère et emmental, il s’agit d’un fromage à trous.
Leur origine a longtemps constitué un mystère. En 1917, l’américain William Clark les a relié à la présence de dioxyde de carbone libéré par des bactéries présentes dans la pâte, dégagement gazeux empêché d’en sortir par l’épaisseur de la croûte… explication qui restait silencieuse sur la provenance de ces germes, Pasteur ayant fait un sort définitif à la théorie de la génération spontanée… Seulement voilà, la raréfaction progressive de ces trous a conduit, en 2015, les chercheurs de l’Agroscope (3) vers une nouvelle hypothèse plus éclairante. La disparition résulte, de façon directe et certaine, du changement du mode de traite. Grace à la tomographie assistée par ordinateur, ils ont pu les corréler à des microparticules de foin tombant dans le lait lors de la traite à seau ouvert. La pratique d’un appareil de traite en circuit fermé, certes plus hygiénique, raréfie ces parcelles, avec des conséquences radicales sur l’aspect du fromage à la coupe.
Conséquence, en jouant sur leur dosage, il serait possible de moduler cette apparence, influant ainsi sur le fameux syllogisme de l’emmental: « plus il y a de fromage, plus il y a de trous, or, plus il y a de trous moins il y a de fromage, donc plus il y a de fromage, moins il y en a. »
Jean-Paul Demarez

