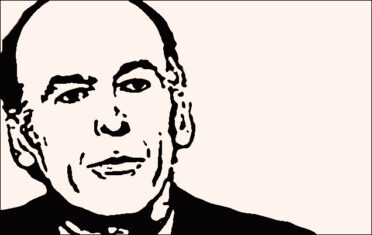 Ce 19 mai 1974, à 20 heures, seul devant son téléviseur, Valéry Giscard d’Estaing savourait son élection à la présidence de la République. Encore pour peu de temps ministre de l’Économie et des Finances du gouvernement Messmer, il occupait un appartement de fonction dans le pavillon Turgot du palais du Louvre. Sous les ors de ce décor Napoléon III, il se sentait assurément plus d’Estaing que Giscard. Et pour cela, grâces soient rendues à son père Edmond, qui avait su procurer un nom prestigieux à sa lignée. En quelques clics sur le mulot, il est possible de retracer cette belle aventure. Tout d’abord, un petit point de droit: selon l’article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Ceci, par égard pour les dénommés Bitodeau, Connard, Zbyniewskipetrovitchi ou Landru, échappant ainsi aux quolibets. La disposition permet également de « relever un nom en voie d’extinction », c’est-à-dire de l’adopter pour l’empêcher de disparaître. Ce, par la validation du Conseil d’État. L’institution n’est pas très sourcilleuse quant à l’intérêt légitime. Elle dispense, en outre, de la nécessité d’un lien direct avec le patronyme espéré. Il est possible de remonter jusqu’à « un ascendant collatéral du demandeur au quatrième degré ». Sauf, bien sûr, opposition d’un tiers habilité.
Ce 19 mai 1974, à 20 heures, seul devant son téléviseur, Valéry Giscard d’Estaing savourait son élection à la présidence de la République. Encore pour peu de temps ministre de l’Économie et des Finances du gouvernement Messmer, il occupait un appartement de fonction dans le pavillon Turgot du palais du Louvre. Sous les ors de ce décor Napoléon III, il se sentait assurément plus d’Estaing que Giscard. Et pour cela, grâces soient rendues à son père Edmond, qui avait su procurer un nom prestigieux à sa lignée. En quelques clics sur le mulot, il est possible de retracer cette belle aventure. Tout d’abord, un petit point de droit: selon l’article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Ceci, par égard pour les dénommés Bitodeau, Connard, Zbyniewskipetrovitchi ou Landru, échappant ainsi aux quolibets. La disposition permet également de « relever un nom en voie d’extinction », c’est-à-dire de l’adopter pour l’empêcher de disparaître. Ce, par la validation du Conseil d’État. L’institution n’est pas très sourcilleuse quant à l’intérêt légitime. Elle dispense, en outre, de la nécessité d’un lien direct avec le patronyme espéré. Il est possible de remonter jusqu’à « un ascendant collatéral du demandeur au quatrième degré ». Sauf, bien sûr, opposition d’un tiers habilité.
Le père d’Edmond, déjà prénommé Valéry, avait tenté cette opération, rattraper le nom d’une grand-mère, pour s’appeler Giscard de la Tour Fondue. Las, Anatole, dernier descendant direct de cette vieille famille auvergnate, rappliqua dare-dare du Canada pour s’y opposer. Aucun risque avec les d’Estaing. Le chef de famille, Charles Henri, l’amiral, était mort guillotiné le 28 avril 1794, sans postérité.
Le cher Edmond jouait, en la circonstance, d’une heureuse homonymie. L’une de ses quadriaïeules maternelles se dénommait Lucie Madeleine Destaing, avec ou sans apostrophe, selon tel ou tel document de l’époque. Cette charmante roturière était la filleule d’une Lucie Madeleine d’Estaing, elle-même demi-sœur adultérine de Charles Henri, celui-ci devenant parrain par procuration. Ce qui fut réinterprété comme une descendante de la main gauche d’une branche adjacente à la parentèle de l’illustre marin. Le Conseil d’État valida l’affaire. Par un heureux concours de circonstances, René, le frère d’Edmond, y était maître des requêtes. Donc, le 17 juin 1922, le sieur Edmond Giscard, administrateur de société, devenait par décret Giscard d’Estaing. Il fut, dès lors, surnommé en catimini par la bonne société clermontoise, monsieur de Puispeu.
Le prurit d’un nom à charnière n’est pas un phénomène récent. Molière s’en gausse, dans l’Ecole des Femmes: « Je sais un paysan qu’on appelait Gros Pierre/Qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre/Y fit, tout alentour, faire un fossé bourbeux/Et de Monsieur de l’Isle en pris le nom pompeux. »
Mais, ainsi nommé, l’on n’est pas pour autant gentilhomme. Il faudrait, à côté de la particule, montrer la partie face: le brevet du monarque décernant à votre ancêtre le titre de baron, comte ou marquis. Sinon, il s’agira de noblesse d’apparence, laissant penser à une éventuelle origine aristocratique, ou de fausse noblesse, prétendant en être sans que cela soit le cas. Subtilités hermétiques à la plupart des manants pour qui le « de » Machinchose est gage de légitimité (1). Ce qui n’a d’importance que mondaine.
En dépit de ces quelques détails, le fils d’Edmond, Valéry, intégrera à fond les fantasmes nobiliaires de son géniteur. Il obéira, avant l’heure, à cette injonction soixante huitarde: « prenez vos désirs pour des réalités. » Sans craindre les rebuffades. Il pointera, par exemple, son museau chez les Cincinati, (2) en tant que descendant de l’amiral, lesquels lui opposèrent un refus poli, mais ferme.. Jeune ministre des finances, il présentera un projet d’emprunt national, proposant, à l’exemple d’Antoine Pinay, de lui donner son nom: emprunt Giscard d’Estaing. « C’est un beau nom d’emprunt », aurait remarqué, sarcastique, le général De Gaulle.
En 2005, VGE a acheté le château d’Estaing, « un retour aux sources…. « (sic), Paris Match en a commenté la visite, avec toute la complaisance requise. Les plumitifs de service nous montrent le bureau de l’ex président, avec, derrière lui, « le portrait de l’un de ses grands oncles, Joachim Joseph d’Estaing, évêque de Saint Flour » (3). Une grande leçon de journalisme, dans le droit fil de ce précepte hollywoodien: « lorsque la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. » (4)
Jean-Paul Demarez


Nous sommes tous descendants d’illustres personnages.
Moult soubrettes pourraient en témoigner. Ceci dit les temps changent, il convient maintenant de s’afficher issue des peuples autochtones, du 93 ou bien encore de quelques gouttes de sang exotique.
Aujourd’hui nous sommes tous des f. de P. respectueuses