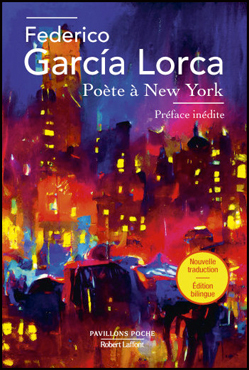 Coup de tonnerre dans le ciel franco-espagnol : «Poeta en Nueva York» («Poète à New York»), œuvre la plus mythique du mythique Federico Garcia Lorca (1898-1936), considérée comme son chef d’œuvre, vient de sortir dans une nouvelle édition bilingue. Deux universitaires, Zoraida Carandell et Carole Fillière, enseignantes aux universités de Nanterre et de Toulouse-Jean-Jaurès, signent cette nouvelle traduction remettant enfin en question la version officielle parue dans «La Pléiade» sous l’autorité de André Belamich en 1981. L’odyssée du manuscrit est l’une des plus mystérieuses de la littérature. L’essentiel de «Poeta en Nueva New York» date du séjour d’un Lorca de trente-et-un an à Columbia University, où il réside plusieurs mois entre 1929 et 1930. Aîné chéri d’une famille patricienne, Federico était alors ce poète, compositeur, pianiste, dramaturge et peintre célébré par l’avant-garde (dite «la génération de 27»), l’ami de Manuel de Falla, de Dali et de Buñuel.
Coup de tonnerre dans le ciel franco-espagnol : «Poeta en Nueva York» («Poète à New York»), œuvre la plus mythique du mythique Federico Garcia Lorca (1898-1936), considérée comme son chef d’œuvre, vient de sortir dans une nouvelle édition bilingue. Deux universitaires, Zoraida Carandell et Carole Fillière, enseignantes aux universités de Nanterre et de Toulouse-Jean-Jaurès, signent cette nouvelle traduction remettant enfin en question la version officielle parue dans «La Pléiade» sous l’autorité de André Belamich en 1981. L’odyssée du manuscrit est l’une des plus mystérieuses de la littérature. L’essentiel de «Poeta en Nueva New York» date du séjour d’un Lorca de trente-et-un an à Columbia University, où il réside plusieurs mois entre 1929 et 1930. Aîné chéri d’une famille patricienne, Federico était alors ce poète, compositeur, pianiste, dramaturge et peintre célébré par l’avant-garde (dite «la génération de 27»), l’ami de Manuel de Falla, de Dali et de Buñuel.
Mais il traversait de son propre aveu «une grande crise sentimentale» et sa famille l’avait poussé à prendre le large en août 1929. Durant la traversée, il enverra ces lignes à son ami diplomate chilien Carlos Lynch : «Je ne sais pourquoi je suis parti ; je me le demande cent fois par jour. Je me regarde dans la glace de l’étroite cabine et ne me reconnais pas… » («Conférences, Interviews, Correspondance», Gallimard, 1960). Trois mois plus tard le ton change, et il écrit de New York à son ami diplomate que «les jours filent dans un rêve». Il a passé l’été au Canada, et entrepris «presque deux livres de poèmes et une pièce de théâtre». La première impression passée, au fil du temps la verticalité minérale newyorkaise va lui sembler de plus en plus rude, et quel bonheur pour lui de s’embarquer de Miami début mars 1930 pour Cuba, où il va retrouver pendant trois mois une terre beaucoup plus proche de son cœur et de ses racines.
Que se passe-t-il une fois revenu en Espagne ? Il fait allusion à ses écrits newyorkais lors d’interviews et de conférences durant les années suivantes, se rend en Argentine en 1933, poursuit comme toujours une activité foisonnante. On en arrive au 13 juillet 1936. Ce jour-là, à Madrid, Lorca dépose sur le bureau de son ami éditeur José Bergamin alors absent un ensemble hybride de textes non paginés, dactylographiés ou autographes, assortis d’indications sur des poèmes et des illustrations à récupérer ici et là pour finaliser son manuscrit «Poeta en Nueva York». Quatre jours plus tard, la guerre civile éclate, et Lorca quitte Madrid pour ses terres d’enfance de Grenade. Les circonstances de sa mort demeurent encore entourées de mystère et de terreur. Arrêté le 16 août, il aurait été fusillé le 19 par les phalangistes, et son corps jeté dans une fosse commune.
Deux premières éditions divergentes du manuscrit auront lieu en 1940, l’une au Mexique par José Bergamin, l’autre en espagnol et en anglais aux éditions Norton de New York. Il faut ensuite faire un bond de soixante-quinze ans pour saluer l’édition espagnole établie par Galaxia Gutenberg à Barcelone en 2015 sous la direction de Andrew A. Anderson. Et voilà enfin ce manuscrit posthume mais fidèle au poète, tout juste traduit en français par les deux universitaires.
Les adorateurs du théâtre de Lorca, de sa passion flamenca vibrante de duende ou du «Romancero gitano» risquent d’avoir un choc en découvrant cet ouvrage de bruit et de fureur. C’est un Lorca nouveau que l’on découvre dans ces dix sections commençant par «Poèmes de la solitude à l’Université de Columbia» («Poemas de la soledad en Columbia University»), s’ouvrant par «Retour de promenade» («Vuelta de paseo») et le vers «Assassiné par le ciel» . De vers libres en vers libres, on en arrive rapidement à «Los negros» («Les noirs»), et à cet Harlem où le poète semble retrouver des frères : «(…) Les Noirs pleuraient confondus/entre parapluies et soleils d’or,/les mulâtres tiraient sur leur chewing-gum avides/d’atteindre le torse blanc,/et le vent embuait les miroirs/et brisait les veines des danseurs (…).»
Suivront «Danse macabre», «Paysage de la foule qui vomit. Crépuscule sur Coney Island», «Ville sans sommeil. Nocturne du pont de Brooklyn», «Panorama aveugle de New York», bien d’autres encore, pour finir par «Son de negros en Cuba» («Son des Noirs à Cuba»): «Lorsque viendra la pleine lune j’irai à Santiago de Cuba,/j’irai à Santiago /dans une voiture d’eau noire (….).»
Cuba, enfin, après Nueva York !
Lise Bloch-Morhange


Bel hommage à un illustre personnage