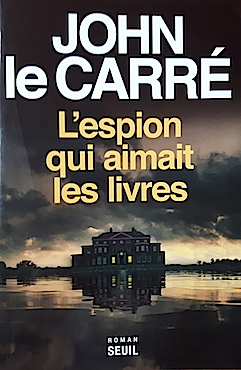 Le roman posthume de John le Carré, «L’espion qui aimait les livres», est de la même veine que les autres : dès qu’on a tourné la dernière page, on refuse de quitter les personnages et on n’a qu’une envie, les retrouver en relisant l’ouvrage. Car la fin jette une lumière nouvelle sur le livre entier, et une seconde lecture permet de mieux savourer chaque épisode. D’autant que fidèle à son habitude, le Carré, alias dans le civil David John Moore Cornwell, disparu le 12 décembre 2020 en Cornouailles, se livre à une composition éblouissante de subtilité, ce que Milan Kundera appelle la composition en sonate.
Le roman posthume de John le Carré, «L’espion qui aimait les livres», est de la même veine que les autres : dès qu’on a tourné la dernière page, on refuse de quitter les personnages et on n’a qu’une envie, les retrouver en relisant l’ouvrage. Car la fin jette une lumière nouvelle sur le livre entier, et une seconde lecture permet de mieux savourer chaque épisode. D’autant que fidèle à son habitude, le Carré, alias dans le civil David John Moore Cornwell, disparu le 12 décembre 2020 en Cornouailles, se livre à une composition éblouissante de subtilité, ce que Milan Kundera appelle la composition en sonate.
Mais à qui doit-on ce miracle ? Son plus jeune fils, Nick Cornwell, lui-même écrivain sous le nom de Nick Harkaway, s’en explique dans la postface. Il nous raconte que quelques années plus tôt, marchant sur Hampstead Street avec son père, celui-ci lui a demandé de s’engager : «s’il venait à disparaitre en laissant une histoire inachevée sur son bureau, accepterais-je de la terminer ?» Et le soir de la mort de ce père, contemplant l’océan, le fils s’est souvenu de «L’espion qui aimait les livres» (en anglais «Silverview»), dont il connaissait l’existence mais n’avait pas lu. «Ce n’était pas un roman inachevé, mais un roman non publié. Retravaillé encore et encore.» Entrepris juste après la publication de «Une vérité si délicate», datant de 2013. Alors pourquoi John le Carré ne l’a-t-il jamais publié ?
Selon la composition en sonate, passant d’un personnage à l’autre, après une brève introduction mystérieuse, nous faisons connaissance de Julian, 33 ans, qui vient d’ouvrir une librairie «dans une petite station balnéaire perdue sur les côtes du Suffolk». Son humeur est plutôt morose, car deux mois «après son abandon impulsif de la jungle de la finance», sa reconversion s’avère peu rentable. Ce doit être un idéaliste s’il a quitté brusquement la City. Il doit être en quête de sens. Mais il se rend compte qu’il ne connaît rien au métier de libraire, les clients sont plus que rares, la solitude difficile à supporter.
Sauf que la veille, quelques minutes avant la fermeture, un inconnu d’un certain âge a fait irruption, se présentant comme Edward Avon, «Avon comme la rivière du même nom». Un personnage en imperméable camel, avec feutre et parapluie, d’une politesse extravagante. Ils se retrouvent le lendemain, comme par hasard, dans la paillote du coin, où Edward révèle brusquement à Julian qu’il fut un condisciple de son père dans leur école privée. Et toujours sur un ton de comédie à l’anglaise, s’insinue dans les bonnes grâces d’un Julian circonspect en suggérant d’installer au sous-sol de sa librairie une «République de la Littérature». Mais qui est donc cet homme, se demande Julian, ex riche trader de la City ? Un vrai amoureux des livres ? Un arnaqueur ? Un doux rêveur ?
Nous passons ensuite à un autre héros du livre, Stewart Proctor, membre de «la dynastie blanche du sud de l’Angleterre», 55 ans, ancien du Foreign Office, en poste à Londres et à travers le monde pendant vingt-cinq ans. Cette semaine, il semble très agité et passe beaucoup de temps dans son arrière-cuisine où trône un téléphone vert. Puis retour chez Jullian, qui découvre d’étranges rumeurs concernant le curieux Edward. Puis retour sur Proctor en mission spéciale sur une base ultra secrète, et nous croyons comprendre qu’il doit détecter «une faille». Bien sûr la faille concerne l’homme à l’imperméable camel qui intrigue tant Julian, et plus encore lorsqu’il découvre qu’il est marié à l’héritière du manoir de Silverview, situé là-bas, au bout du village. Par petites touches, d’un lieu à l’autre, d’une scène à l’autre, Julian fait son apprentissage sur son nouvel ami Edward, sur lequel les services secrets resserrent leur étau. L’inimaginable est-il possible ?
C’est toute la question, celle que soulève Nick Cornwell dans la postface, en se demandant pourquoi son père n’avait pas pu se résoudre à publier cet excellent roman plein de verve. Son hypothèse, son intuition étant que ce dernier ne pouvait se résoudre à montrer pour la première fois «un service divisé entre plusieurs factions politiques, pas toujours bienveillant envers ceux qu’il devait protéger, pas toujours efficace ou attentif, et en fin de compte, plus très sûr d’arriver à se justifier lui-même».
Tel est le cœur de «L’espion qui aimait les livres», l’ultime chef d’œuvre du grand romancier (titre français résonnant avec «L’espion qui venait du froid», qui le rendit mondialement célèbre en 1963).
Lise Bloch-Morhange
«L’espion qui aimait les livres», John le Carré, 2022, Seuil, 22 euros


J’avais adoré ce livre. Merci pour ce bel article, vivant et incisif qui devrait séduire de nombreux lecteurs.