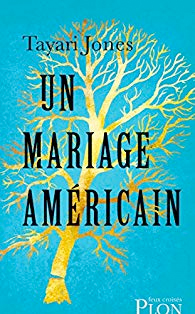 À en croire la promotion commerciale, Barack Obama aurait dit « bouleversant » en évoquant « Un mariage américain », le dernier roman de Tayari Jones, le premier traduit en français. Ce n’est pas la première fois que l’ancien président des États-Unis est recruté – malgré lui ? – comme VRP par les éditeurs. Dans ce cas particulier, il est en bonne compagnie : The New York Times Book Review, Elle, Les Échos, ou encore le « Women’s Prize for Fiction 2019 » décerné au livre, forment un chœur louangeur. Et ils disent en gros ceci : c’est une magnifique plongée dans la middle class noire américaine.
À en croire la promotion commerciale, Barack Obama aurait dit « bouleversant » en évoquant « Un mariage américain », le dernier roman de Tayari Jones, le premier traduit en français. Ce n’est pas la première fois que l’ancien président des États-Unis est recruté – malgré lui ? – comme VRP par les éditeurs. Dans ce cas particulier, il est en bonne compagnie : The New York Times Book Review, Elle, Les Échos, ou encore le « Women’s Prize for Fiction 2019 » décerné au livre, forment un chœur louangeur. Et ils disent en gros ceci : c’est une magnifique plongée dans la middle class noire américaine.
Assurément, tous les protagonistes sont noirs et appartiennent à cette classe moyenne dont l’on comprend néanmoins qu’elle n’est pas tout à fait homogène. L’affaire se passe à parts égales entre la Géorgie et la Louisiane. Mais manifestement grandir et vivre à Atlanta, comme Celestial, n’offre pas tout à fait les mêmes occasions que grandir à Eloe en Louisiane, comme Roy. Il fallait donc un terrain neutre pour que naisse l’amour entre ces deux-là, et ce sera New York. A ce stade, le titre n’est pas trompeur, l’auteur nous parlera bien d’un mariage américain.
Soit un mariage qui n’a que dix-huit mois d’existence au début du livre mais qui a encore quelques fondamentaux à stabiliser : bébé ou pas bébé ? est-ce que tes parents m’ont jamais accepté ? faut-il vraiment passer Thanksgiving chez eux tous les ans ? … Roy et Celestial se posent des questions et se découvrent. C’est ainsi à l’occasion d’une expédition chez ses parents que Roy raconte pour la première fois à sa femme que son père, Big Roy, n’est pas son père biologique qui, lui, a pris la tangente avant l’accouchement. Entrée en scène du mensonge conjugal sur le mode : « et tu m’as caché beaucoup d’autres choses encore ? ». La soirée commence mal. Elle se terminera en drame. Roy et Celestial préférant dormir dans un motel plutôt que chez les parents de Roy, ce dernier se retrouve au beau milieu de la nuit accusé d’avoir violé une autre cliente – blanche – de l’établissement et se retrouve embarqué manu militari par le shériff, puis un peu plus tard condamné dans un procès sous-entendu comme partial et expéditif à douze ans de prison.
Avant de hurler avec l’auteur contre le système judiciaire américain qui ferait de tout inculpé noir un présumé coupable, on aimerait avoir plus de détails sur les faits, sur les preuves ou l’absence de preuve, sur les plaidoiries… Quitte à faire une « plongée dans la middle class noire américaine », plongeons ! Non, en tout cas pas dans ce livre-ci. Même si l’on sait, nous lecteurs, que Roy n’est pas coupable puisque Celestial et lui étaient en train d’essayer de se réconcilier dans leur chambre après une énième querelle. Mais les lecteurs américains ont peut-être besoin de moins de détails que les lecteurs étrangers pour savoir de quoi il retourne en matière de justice inique.
Reconnaissons aussi que le propos de l’auteur est avant tout « le mariage américain ». Et ce mariage doit donc rapidement composer avec le long séjour en prison d’un des protagonistes, pour une faute qu’il n’a pas commise, pas de discussion là-dessus, Celestial et ses proches n’ont aucun doute sur l’innocence de Roy. Mais l’absence et l’éloignement se révèlent évidemment être des poisons. Depuis sa prison, Roy sent sa femme s’échapper. Elle s’échappe d’ailleurs tellement qu’elle cesse de lui rendre visite et demande à son oncle avocat, le même qui défend Roy, d’établir les documents du divorce. Et puis, coup de théâtre, Roy, à force de recours devant les tribunaux, est reconnu innocent et libéré au bout de cinq ans. À la grande surprise de Celestial qui suivait donc l’affaire avec moins d’assiduité depuis quelque temps, avec d’autant moins d’assiduité qu’elle vivait une nouvelle histoire d’amour avec Andre, son ami d’enfance, celui grâce à qui elle avait rencontré Roy, justement.
Peut-on retricoter un mariage dans ces conditions et alors que nous sommes déjà à la moitié du roman ? La réponse advient au bout de quelques longues scènes, bavardes et parfois difficiles à suivre parce que l’auteur a choisi de nous les faire vivre à trois voix. Roy, Celestial et Andre insistent bien : « View my point ».
Et ce choix du « view my point » se révèle vite laborieux parce que Tayari Jones veut en fait démontrer que tout le monde est de bonne foi et que personne n’a ni tort ni raison. Les injustices de la société américaine sont clairement sur le banc des accusés et des circonstances aggravantes. L’amour des parents et l’importance de la transmission sont confortablement assis sur le banc de la défense et des circonstances atténuantes (était-il néanmoins indispensable d’imaginer que Roy partagerait sa cellule avec un homme dont il s’avèrera qu’il est son père biologique alors qu’il doit y avoir des millions de cellules de prison dans tous les États-Unis ???). Tayari Jones refuse de prendre parti et invente un improbable dénouement qui lui épargnera de trancher.
Certains éditeurs anglo-saxons ayant la pédagogie un peu lourde et voulant sans doute aider les lecteurs à bien comprendre ce qu’ils viennent de lire, adjoignent un « guide de lecture » en toute fin de volume. Il y en a donc un dans la version anglophone de ce « Mariage américain » qui nous apprend que, à l’origine, l’auteur avait choisi de ne parler qu’au travers de la voix de Celestial mais que la complexité de ce drame conjugal avait finalement exigé une chorale à trois voix. Mmmm… on peut en douter. Parce que, même si une longue incarcération n’est pas une circonstance tout à fait ordinaire, ce mariage américain demeure une histoire de trio amoureux assez connue et les marqueurs sociaux qui la jalonnent de façon appuyée ne suffisent pas à la nourrir.
Marie J
« Un mariage américain ». Tayari Jones. Traduit par Karine Lalechère. 432 pages. Éditions Plon.


Merci pour votre critique… qui me donne envie de lire le livre car tous vos arguments contre le livre ne me paraissent pas convaincants… et paradoxalement en faveur d’un livre…
Quand on est noir aux Etats-Unis, on sait qu’on est sous la menace d’un procès inique quand on se retrouve pris dans une affaire…
Le parti-pris déterministe, on dirait à la Bourdieu en France, me paraît aussi un élément favorable au livre alors qu’il vous paraît négatif… Que « chacun a ses raisons », selon le mot de Raymond Aron est le b.a ba du bon sociologue… et du bon romancier…
Si je me fais une opinion du livre par votre critique : « Un mariage américain » est la version noire du livre majeur de Theodor Dreissler, « Une tragédie américaine » (qui a donné au cinéma « Une place au soleil » et que Woody Allen -selon son habitude- a plagié sans le dire dans « Match Point »). Tayari Jones est donc un grand romancier mais pas forcément un grand écrivain… Il faut le lire ! (ce que je ferai !)
Merci, Marie, pour votre critique avisé qui m’évitera ainsi de perdre mon temps à la lecture de ce roman. C’est donc l’âme apaisée que je retourne à ma relecture d’Anna Karénine. Ce n’est pas tous les jours que naissent des chefs-d’oeuvre…
Comment peux t’on imaginer un seul instant, qu’une personnalité américaine (mais pas que…) puisse « conseiller » quoi que se soit sans rétribution. La famille Obama est rompue à ce genre « d’intervention gratuite ». Business is business, le livre est un produit. Il faut donc le faire acheter pour le faire lire.
Ce n’est pas parce qu’Obama dit que le livre est bon… qu’il est forcément mauvais…
Je trouve un peu pénible le débat autour d’un livre qui pour une fois ne décrit pas l’Amérique blanche…
Au contraire d’Isabelle, je le répète, la mauvaise critique de Marie J me donne envie de lire le livre… j’en ai tellement assez de ses livres « petits blancs américains » tous formidables, d’autant plus qu’ils ne traitent pas la principale turpitude de l’Amérique qui est justement encore et toujours le traitement des noirs… Rappelez vous que Philip Roth, lui, a astucieusement traité la question avec La Tâche.
Et puis, on a tellement lu de livres d’écrivains blancs américains sans américains vantés par des gens bien moins recommandables qu’Obama pour, une fois, lire une écrivaine noire américaine recommandée par le seul président noir du pays où le racisme se lit partout : De la conquête spatiale (combien de pieds noirs se sont posés sur la lune ? ) aux cimaises (à part Basquiat, haïtien) combien de peintres noirs aux côtés des Jeff Koons et consorts !!!
J’avoue, pour ma part, qu’à l’exception de Toni Morrisson, je n’ai jamais lu d’écrivaines noires nées aux Etats-Unis… À la rigueur, je pourrais aussi ajouter Angela Davis… Mais c’est quand même un gros problème…