 Un géant de la littérature américaine vient de s’éteindre à 85 ans le 22 mai, un écrivain dans la lignée des Saul Bellow ou Bernard Malamud (génération précédente), se réclamant volontiers de Henry James, Franz Kafka ou Tchekhov.
Un géant de la littérature américaine vient de s’éteindre à 85 ans le 22 mai, un écrivain dans la lignée des Saul Bellow ou Bernard Malamud (génération précédente), se réclamant volontiers de Henry James, Franz Kafka ou Tchekhov.
Il est étonnant de penser à quel point il a eu des problèmes avec les Américains dès ses débuts, que ce soit lors de la parution de son premier livre, « Goodbye Colombus » (1959), puis avec «Portnoy et son complexe» (1969), très mal reçu par la communauté juive qui ne comprend pas la plaisanterie et le désigne à la vindicte comme «un mauvais juif», un «juif anti juif», etc.
Pourtant ce premier recueil de nouvelles est couronné par le National Book Award, un fait rarissime, puis Portnoy, paru dix ans plus tard, devient un immense succès, mais dès ces deux premiers livres, l’étiquette de «juif antisémite» va lui coller à la peau, et il est difficile pour nous, Européens, d’imaginer la violence des réactions Outre-Atlantique. Si bien qu’au moment où il vient de s’éteindre, critiques et amis ne cessent de rappeler sa réaction à propos de la cérémonie s’étant tenue à la Grande Synagogue de New York en 2013, pour célébrer ses quatre-vingt-ans. Il n’avait pas pu y assister parce qu’il était malade, mais lorsqu’on lui a rapporté qu’on avait lu un passage de «Portnoy et son complexe» dans l’auditorium de la synagogue, il est parti d’un grand éclat de rire en s’écriant : «J’ai gagné !» (article du Monde daté du 24 mai).
Comment comprendre pour nous Européens que ce livre ait pesé si longtemps sur sa réputation d’écrivain aux States, alors que je me souviens encore avoir adoré sa force explosive, sans imaginer que la confession de cet Alexander Portnoy, newyorkais de trente-trois-ans, évoquant pour son psychanalyste les complexités de son éveil sexuel d’adolescent et son obsession de la masturbation, pouvait faire scandale. Après tout, lorsque j’ai lu sa traduction française, nous étions en 1970, en pleine libération sexuelle, mais Outre-Atlantique, la crudité des termes ne passait pas, pas plus que la virulente satire de l’éducation juive.
Apparemment, les Américains avaient oublié le dicton «qui aime bien châtie bien», et le malentendu perdurait, non seulement sur son identité juive, mais sur son lieu de naissance, ce quartier juif de Weequahic nommé Newark, qu’il ne cessait de faire vivre dans ses romans. Pourtant que fait d’autre un romancier ?
De même lui reprochait-on d’écrire des autobiographies déguisées, mais que fait d’autre un écrivain ? Il parait que lorsqu’il publie «Ma vie d’homme» en 1974, on y voit le récit de son mariage désastreux avec sa première femme, et on lui colle l’étiquette de misogyne. Qui va ressurgir lors de son orageux divorce d’avec l’actrice anglaise Claire Bloom en 1995.
Entre-temps, il a vécu l’étonnante parenthèse tchèque, se rendant chaque printemps à Prague, de 1972 à 1977, sur les traces de Kafka, mais surtout pour prendre du recul. Il y rencontre Kundera et autres, et s’implique passionnément dans le combat de ces écrivains pour lesquels l’écriture est une question de vie et de mort. Lui-même à la recherche de son identité d’écrivain, il aborde à partir de 1979 le cycle des Nathan Zuckerman, avec «L’écrivain fantôme», «Zuckerman délivré» (1982) et «La leçon d’anatomie» (1983). Bien entendu, Zuckerman est le double de l’auteur, et le malentendu entre une bonne partie de son électorat américain perdure, y compris après ces très grands Roth que sont «La Contrevie» (1986), «Opération Shylock» et «Le théâtre de Sabbath» (1995), fable grinçante et mordante qui lui vaut le National Book Award, même si beaucoup de ses compatriotes la détesteront.
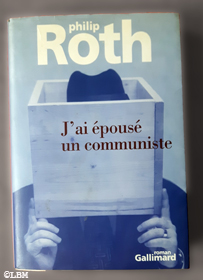 En France, sa renommé lui viendra surtout de la fameuse trilogie «Pastorale américain » (1997), «J’ai épousé un communiste» (1998), et «La tâche» (2000), best-seller et prix Médicis étranger en 2002. Bizarrement, la critique américaine persiste à y voir des règlements de compte, alors qu’en Europe on applaudit à cette brillante et virulente dénonciation des travers de la société américaine, qu’il s’agisse de la guerre du Vietnam, des années maccarthystes, ou du racisme anti-Noir notamment. Indéniablement, Philip Roth possède au plus haut point ce talent si américain des grands écrivains ou cinéastes de son pays capables d’inscrire le destin de leurs personnages dans la trame de l’Histoire.
En France, sa renommé lui viendra surtout de la fameuse trilogie «Pastorale américain » (1997), «J’ai épousé un communiste» (1998), et «La tâche» (2000), best-seller et prix Médicis étranger en 2002. Bizarrement, la critique américaine persiste à y voir des règlements de compte, alors qu’en Europe on applaudit à cette brillante et virulente dénonciation des travers de la société américaine, qu’il s’agisse de la guerre du Vietnam, des années maccarthystes, ou du racisme anti-Noir notamment. Indéniablement, Philip Roth possède au plus haut point ce talent si américain des grands écrivains ou cinéastes de son pays capables d’inscrire le destin de leurs personnages dans la trame de l’Histoire.
Le (très) grand écrivain approfondit son exigeante recherche d’identité et son obsession de la vieillesse et de la mort en publiant régulièrement jusqu’en 2010, jusqu’à ce jour de 2012 où lors d’une interview avec les Inrockuptibles, il indiquera qu’il a décidé de mettre fin à son «addiction de l’écriture». Ne plus publier, et peut-être même ne plus écrire.
Il est vrai qu’il a toujours écrit debout, face à un large pupitre, et que son dos ne s’arrange pas, malgré ses baignades dans le lac de sa maison du Connecticut, simple demeure de bois gris entourée d’arbres et de silence, son refuge datant d’après Portnoy.
S’il est heureux qu’il soit entré de plein droit «de son vivant» dans La Pléiade en octobre 2017, il est tout aussi scandaleux qu’il n’ait pas obtenu le Prix Nobel.
Lise Bloch-Morhange
 – Toute son œuvre est disponible en français chez Gallimard
– Toute son œuvre est disponible en français chez Gallimard
– DVD Arte Cineteve Philip Roth sans complexe de W. Karel et L. Manera (la photo d’écran ci-contre en est issue et montre une caricature de Philip Roth par David Levine)


Ping : Charles Lindbergh, 33ème Président des États-Unis | Les Soirées de Paris
Ping : Philip Roth et « Les faits » | Les Soirées de Paris