 Dans son dernier ouvrage, “Civilisation. Comment nous sommes devenus américains”, en tout point captivant et paru ce printemps aux éditions Gallimard, l’écrivain et philosophe Régis Debray nous met face à notre américanité. “Le XXe siècle fut américain” nous dit-il. A travers un récit factuel des plus passionnants, sans émettre aucun jugement, il ravive notre mémoire et reprend le déroulement de l’emprise que l’Amérique exerça sur notre civilisation au cours des ans, de l’empreinte qu’elle y laissa, qu’il s’agisse de notre politique à l’international, de notre langage truffé d’anglicismes, de notre mode de consommation, des films et séries que nous regardons, de la musique que nous écoutons, des artistes qui firent l’histoire de l’art du XXème siècle … Soyons réalistes : l’Amérique donne le “la” et nous suivons.
Dans son dernier ouvrage, “Civilisation. Comment nous sommes devenus américains”, en tout point captivant et paru ce printemps aux éditions Gallimard, l’écrivain et philosophe Régis Debray nous met face à notre américanité. “Le XXe siècle fut américain” nous dit-il. A travers un récit factuel des plus passionnants, sans émettre aucun jugement, il ravive notre mémoire et reprend le déroulement de l’emprise que l’Amérique exerça sur notre civilisation au cours des ans, de l’empreinte qu’elle y laissa, qu’il s’agisse de notre politique à l’international, de notre langage truffé d’anglicismes, de notre mode de consommation, des films et séries que nous regardons, de la musique que nous écoutons, des artistes qui firent l’histoire de l’art du XXème siècle … Soyons réalistes : l’Amérique donne le “la” et nous suivons.
D’une grande lucidité, sans défaitisme ni amertume aucune, dans un style d’une belle limpidité et non dénué d’humour, appelant un chat un chat, l’auteur nous parle de la perte de notre hégémonie et tente d’en comprendre le processus. Et nous tranquillise. Car Régis Debray, tout comme son aîné Michel Serres, n’est pas de ces vieilles personnes ronchonnes qui clament que tout était mieux avant. La décadence de la civilisation européenne n’a rien de grave, nous rassure-t-il. Elle se situe même dans l’ordre des choses. Qu’y a-t-il de terrible à quitter le devant de la scène ? Rien n’est jamais acquis définitivement. Les civilisations se succèdent les unes aux autres et il faut bien que l’une décline pour qu’une autre naisse et grandisse, étant donné que la nouvelle intègrera toujours des composants de la précédente. Il s’agit là d’un processus de transmission. “Cela ne veut pas dire quitter la place, mais changer de fonction. Et souvent pour un mieux”. Nous voilà rassérénés. Que les pessimistes et déclinistes se le disent, la culture et l’esprit français ne sont pas morts pour autant !
Dans son analyse très fine et pertinente de la “décadence” de la civilisation européenne et de son américanisation, l’auteur, en tout bon philosophe qu’il est, avance par étapes à travers différents questionnements qu’il lui semble légitime de se poser pour bien appréhender le sujet : tout d’abord, qu’entend-on par “civilisation” ? Quand l’Europe a-t-elle cessé d’être une civilisation ? Quand la France est-elle devenue une culture ? Qu’est-ce que la nouvelle civilisation ? Qu’a donc de nouveau la nouvelle Rome ? Pourquoi les “décadences” sont-elles aimables et indispensables ?…
Pour Régis Debray, la notion de civilisation dépasse la notion de culture de par les trois concepts qui la composent : la langue, la religion et l’empire. Elle comprend une forme de pensée, mais aussi une force de frappe. Pour simplifier : “Une culture construit des lieux, une civilisation des routes”.

Andy Warhol au MoMa
Une fois cette définition établie et pour comprendre à quel moment l’Europe a cessé d’être une civilisation, l’auteur part du constat que fit, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce visionnaire de Paul Valéry dans son essai “La crise de l’Esprit” (1919) : “Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles”. Pour Valéry, le terme de “civilisations” se référait alors à l’Europe. Quatre-vingt-dix ans plus tard, l’Américain Samuel Huntington dans “Le choc des civilisations” (1996) fait l’inventaire des civilisations et ne mentionne plus l’Europe. La civilisation occidentale, pour lui, est la civilisation américaine. Que s’est-il passé entre ces deux constats ?
En 1919, il y avait une civilisation européenne avec, pour variante, une culture américaine et, en 2017 comme en 1996, une civilisation américaine avec, pour variantes, des cultures européennes. En un siècle, l’ordre du monde s’est radicalement inversé.
Par ailleurs, la destitution de l’Homo politicus par l’Homo oeconomicus – l’Homo politicus qui lui-même, au siècle des Lumières, avait destitué l’Homo religiosus – participe à cet état de fait, nous rappelle le philosophe.
Pour illustrer son propos, Régis Debray a l’amusante idée de s’imaginer en une sorte d’Hibernatus qui retournerait de nos jours dans le Quartier latin, le quartier qu’il fréquenta, étudiant, dans les années 1960. Plus de cinquante ans après, il arpente le Boulevard Saint Michel et ses alentours pour y noter de notables changements. L’américanisation est passée par là et le quartier, avec ses airs américains (McDonald, Quick, Starbucks Coffee, Gap et autres enseignes US), n’a plus grand-chose de bien latin. Le premier choc passé, notre Hibernatus s’aperçoit cependant que certains repères subsistent : quelques brasseries et boutiques de produits artisanaux bien de chez nous, des cinémas d’art et d’essai, la mythique librairie Gibert, des statues d’écrivains – français –… Tout n’est pas perdu. Le quartier a juste évolué, aboutissement d’un mixte de deux cultures. Il est devenu en quelque sorte “galloricain”.
Plus loin dans son récit, Régis Debray tente un essai de chronologie afin d’identifier les faits marquants de notre américanisation. La liste est longue, mais non pas exhaustive. Les dates se succèdent : de 1919 où le français cesse d’être la langue de la diplomatie avec la rédaction en anglais du traité de Versailles jusqu’à 2017 où le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron écoute La Marseillaise, non pas les bras le long du corps comme le veut la tradition, mais le bras droit replié et la main sur le cœur, tel un citoyen américain écoutant l’hymne national. Tout un symbole…

Paysage américain
Mais quelle est cette nouvelle civilisation américaine dont on parle ? Selon Régis Debray, elle repose sur trois valeurs qui jusqu’alors ne nous étaient pas familières, à nous Européens : l’espace, l’image et le bonheur. L’Amérique est le pays des grands espaces. La route est indissociable de son paysage, comme l’évoquent de nombreuses œuvres américaines (“On the road”, le roman-culte de Kerouac, “Easy Rider”, le film non moins culte de Fonda et Hopper, et tant d’autres…). Pour transporter une information à travers des espaces aussi gigantesques, il faut communiquer. La communication a ainsi occupé une place prédominante aux États-Unis, puis dans notre monde actuel. La vieille Europe, elle, se réfère davantage à la notion de temps et de transmission. Deuxième valeur : l’image. L’Amérique est venue jusqu’à nous par l’image, l’image fixe puis l’image animée : Charlie Chaplin, Walt Disney, Hollywood, John Wayne, Marilyn, le cinéma en technicolor, les blockbusters… tandis que la culture européenne repose davantage sur l’écrit. Et puis, pour finir, l’Amérique véhicule l’image du bonheur, du bien-être personnel. Revêtir un sourire éclatant en toutes circonstances relève de la bienséance. Le spleen baudelairien ne ferait pas recette au pays de l’Oncle Sam.
La puissance technologique des États-Unis (la télévision, le cinéma, le numérique…), une emprise économique d’envergure et un système d’empreintes sociales et culturelles ont permis cette situation d’hégémonie sur les pays européens. Mais il n’y a pas là de quoi dramatiser. D’ailleurs, l’empreinte culturelle américaine n’est pas forcément mauvaise puisqu’elle comprend aussi la contre-culture qui lui est attachée.
Régis Debray termine son essai sur une note optimiste qui ne manquera pas de réconforter les plus pessimistes. Selon lui, les décadences sont les moments les plus féconds d’une civilisation, ceux de la transmission et du rebond. Lorsqu’elle arrive au moment de son déclin, une civilisation peut alors donner naissance à d’autres civilisations auxquelles elle aura transmis ses caractéristiques. “Du Quattrocento au siècle américain, l’Europe occidentale a rempli son contrat, et peut quitter la pole position la tête haute. Qu’elle soit en passe de raccrocher les gants n’a rien de scandaleux. Elle aura transmis le témoin.” La France, elle, changera de fonction : sortie de la civilisation dominante, elle redeviendra une culture à part entière, une culture dont l’Esprit n’est pas mort. L’esprit de résistance non plus, nous permettons-nous de préciser.
Isabelle Fauvel
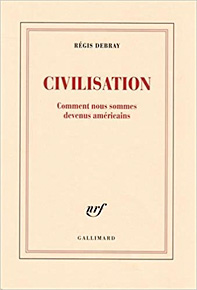 “Civilisation. Comment nous sommes devenus américains” de Régis Debray, Collection Blanche, Gallimard. Parution mai 2017. 19€.
“Civilisation. Comment nous sommes devenus américains” de Régis Debray, Collection Blanche, Gallimard. Parution mai 2017. 19€.


Ping : Régis Debray raconté par sa fille | Les Soirées de Paris