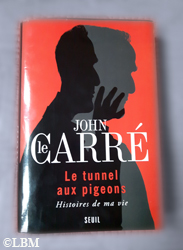 Pourquoi diable John le Carré a-t-il décidé d’écrire ses mémoires à 85 ans ?
Pourquoi diable John le Carré a-t-il décidé d’écrire ses mémoires à 85 ans ?
Il l’avoue très vite, dès la page 17 : « Et j’adore écrire. J’adore faire ce que je suis en train de faire en ce moment, noircir du papier comme un homme traqué [….]. »
Tels sont les grands écrivains, et j’ai toujours considéré John le Carré comme un romancier de premier plan, l’aspect roman d’espionnage passant au second plan (bien qu’il sache nous tenir remarquablement en haleine).
Il fait partie de ces grands du polar et autres thrillers qui nous proposent une vision du monde et un style adéquat. Dans mon panthéon personnel, après les précurseurs Arthur Conan Doyle (et son surhomme de Sherlock Holmes) et Agatha Christie (qui se moque durement de son petit Poirot belge), viennent les grands américains : dans les années 1930, Dashiell Hammett «a sorti le crime de son vase vénitien et l’a flanqué dans le ruisseau», comme le dit si bien son successeur Raymond Chandler, le père de Philip Marlowe (pour moi peut-être le plus écrivain de tous).
Les contemporains ont suivi, tels Colin Dexter et son Chief Inspector Morse (qui n’aime que la poésie et l’opéra) ou M. V. Montalban et son privé barcelonais Pepe Carvalho qui brûle ses livres dans sa bibliothèque un à un. Ou encore l’Ecossais Philip Kerr parvenant à nous passionner pour ce Bernie Gunther tachant de survivre dans l’Allemagne nazie. Sans oublier ce lourdaud de Maigret, bien sûr.
Toutes ces créatures, au demeurant immortelles, vous en conviendrez, dépassent largement les stéréotypes du polar, y compris celle de John Le Carré, dear old George, alias George Smiley à la quarantaine bedonnante et aux airs patelins, dont les yeux mi-clos cachent une intelligence fulgurante qui peut se révéler sans pitié. Comme Doyle nous ayant révélé que son héros omniscient lui avait été inspiré par un ancien professeur de l’Ecole de médecine d’Edimbourg à l’esprit acéré, Le Carré nous indique négligemment, au détour de la page 11, que son héros eut pour modèle « le sage Vivian Green, professeur du Lincoln College à Oxford ». Accessoirement, le sage Vivian lui donna de quoi poursuivre ses études quand son « père indigne » connut une de ses nombreuses périodes de dèche.
Bourré d’anecdotes remarquables, ce livre de mémoires est avant tout un témoignage exceptionnel sur la genèse littéraire d’une œuvre exceptionnelle.
L’auteur nous en donne certaines clefs, se demandant une fois de plus ce qu’aurait été sa vie s’il n’avait pas déclaré un beau jour à son escroc de père, avec toute la brusquerie d’un adolescent ayant pris une décision irrévocable : « Père, vous pouvez me faire ce que vous voudrez, je n’y retournerai pas ». Quoi que fit Ronnie Cornwell, David, son fils cadet, souhaitant en réalité couper les ponts avec ce père catastrophique, ne retourna pas à l’université. Il fila poursuivre ses études à Berne, où il tomba définitivement amoureux de la littérature allemande (comme son mentor Vivian, d’ailleurs).
 Vient l’époque du malentendu qui a coloré toute sa vie. Se trouvant à trente ans, « dans un état de stress personnel intense », jeune diplomate en poste à l’ambassade britannique de Bonn recruté par les services secrets de sa Majesté, il se lance dans l’écriture de son troisième livre, « L’espion qui venait du froid » (The spy who came in from cold), peinture très glauque de la guerre froide.
Vient l’époque du malentendu qui a coloré toute sa vie. Se trouvant à trente ans, « dans un état de stress personnel intense », jeune diplomate en poste à l’ambassade britannique de Bonn recruté par les services secrets de sa Majesté, il se lance dans l’écriture de son troisième livre, « L’espion qui venait du froid » (The spy who came in from cold), peinture très glauque de la guerre froide.
Bien entendu, comme il s’en est déjà expliqué dans la remarquable préface inédite, « Cinquante ans plus tard », de la réédition de ce livre en 2013, il sollicite l’approbation de ses supérieurs secrets qui la lui accordent bien volontiers (ses deux ouvrages précédents, signés du pseudonyme John le Carré, étant demeurés obscurs). Et voilà que ce petit livre d’espionnage d’un jeune auteur inconnu, publié en 1963, devient un succès mondial overnight, et le jeune auteur inconnu sacré le plus grand espion du monde.
John Le Carré, alias David Cornwell, a passé ensuite sa vie à tenter de faire comprendre qu’il n’était qu’un espion des plus subalternes (5 ans seulement, d’ailleurs étant tenu au secret, il ne pouvait rien dire là-dessus…), et que son Alec Leamas, revenu de tout et manipulé sans pitié par ses supérieurs, était essentiellement le fruit de son imagination littéraire.
« Chaque interview que j’ai donné ensuite pendant cinquante ans, écrit-il dans cette préface, m’a semblé systématiquement vouée à révéler au grand jour une vérité qui n’était pas censée exister […] ».
Croyant qu’on lui dévoile enfin les errances du monde parallèle de l’espionnage, le public ne comprend pas que ce monde est né de l’imagination d’un grand écrivain « poussé aux limites de ses possibilités par un dégoût de la politique, et un état de confusion personnel ». Et l’écrivain de tenter de lever, une fois de plus, dans ses mémoires, le malentendu :
« Du monde secret que j’ai connu jadis, j’ai essayé de faire un théâtre pour les autres mondes que nous habitons. D’abord vient l’imaginaire, puis la quête du réel. Et ensuite, retour à l’imaginaire, et au bureau devant lequel je suis assis à cet instant. »
C’est précisément ce qu’il nous raconte dans ses mémoires, cet aller-retour perpétuel entre l’imaginaire et la réalité. Aiguillonné par son imagination, il parcourt le monde entier, dont certains de ses théâtres d’opération les plus dangereux (à Ventiane, au Liban avec Arafat, chez les Ingouches, au Congo, etc, etc…), pour s’imprégner de la saveur et violence des lieux, et rencontrer parfois, en chair et en os, les personnages qu’il a déjà en tête (tel le Gerald Westerby de « Comme un collégien »), ou les découvrir sur place, tel « Le tailleur de Panama ».
Prenant grand soin de nous raconter ses aventures vécues, anecdotes comprises, avec tout le suspense voulu, il se moque allègrement des pseudos importants de ce monde comme de lui-même. Quel talent d’observation (propre aux espions) et d’écriture, quand il évoque des personnalités hors normes comme Fritz Lang ou Stanley Kubrick.
Dans un des chapitres les plus drôles, « Richard Burton a besoin de moi », il aborde le tournage du film tiré de « L’espion qui venait du froid », évoquant avec son humour virulent et subtil la complexité des rapports entre le cinéaste Martin Ritt et l’acteur alors au fait de sa gloire, accompagné d’une « suite » de dix-sept personnes dont sa jeune épouse Liz Taylor (privée du rôle féminin au profit de Claire Bloom) faisant irruption sur le tournage en Rolls blanche. Autant dire un affrontement de chaque instant entre la star dotée de tous les défauts du monde aux yeux de son metteur en scène autrefois mis sur la liste noire d’Hollywood, demeuré viscéralement de gauche. Un de ces affrontements qui font les grands films, en l’occurrence remarquablement fidèle au livre.
Et oui, il ne manque pas de nous livrer une des clefs fondamentales de son œuvre. Dès la page 35, il nous prévient : « L’espionnage et la littérature marchent de pair. Tous deux exigent un œil prompt à repérer le potentiel transgressif des hommes et les multiples routes menant à la trahison. »
Quelle belle définition de la littérature !
Et de préciser un peu plus bas : « Ce n’est pas l’espionnage qui m’a initié au secret. La tromperie et l’esquive avaient été les armes indispensables de mon enfance. A l’adolescence, nous sommes tous plus ou moins des espions, mais moi j’étais déjà surentraîné. Quant le monde du secret vint me chercher, j’eus l’impression de revenir chez moi. Vous découvrirez pourquoi en temps et heure, dans le chapitre intitulé « Le fils du père de l’auteur ».
Il y vient enfin page 295 : « Il m’a fallu de longues années pour arriver à écrire sur Ronnie l’escroc, le mythomane, le repris de justice, et par ailleurs mon père. » (Ce qui n’est pas sans rappeler, dans un style et contexte totalement différents, le père de Patrick Modiano compromis pendant la dernière guerre mondiale).
On touche alors au cœur même de l’œuvre et de la personnalité de David Cornwell alias John Le Carré, elles mêmes tournant éternellement autour de ce père improbable, fascinant coupable, véritable personnage de roman, dont il ne fera jamais le tour. De même avoue-t-il au détour de ce chapitre crucial, évoquant ses retrouvailles avec sa mère, qu’elle lui restera à jamais une étrangère.
Chapitre qui nous renvoie au titre étrange de ses mémoires, « Le tunnel aux pigeons », dont il s’explique dès la préface, plaçant le livre entier sous ses auspices.
Lise Bloch-Morhange
« Le tunnel aux pigeons -Histoires de ma vie », traduit de l’anglais par Isabelle Perrin, éditions du Seuil, 368 p., 22 €.


Superbe article, Lise, tellment drôle , subtilement eliptique et à la fois qui va à l’essentiel et donne vraiemment envie de lire le livre de john Le Carré;
Bravo,
Veronika Lake
Thanks Veronika Lake!!!!!!!!!!!!!!!
Ping : Le stupéfiant héritage des espions | Les Soirées de Paris
Ping : Le Carré et Cie anti-Brexit | Les Soirées de Paris