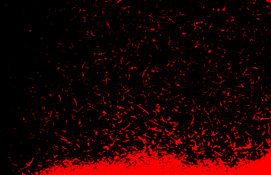 Le mieux dans les dîners en ville c’est d’avoir une opinion sur le sujet qui surgira forcément à un détour de la conversation telle une sale bête aux aguets : le « burn out ». Autrefois, enfin, au mitan des années soixante, on appelait ça le « nervous breakdown », ce qui est en fait la conséquence du « burn out ».
Le mieux dans les dîners en ville c’est d’avoir une opinion sur le sujet qui surgira forcément à un détour de la conversation telle une sale bête aux aguets : le « burn out ». Autrefois, enfin, au mitan des années soixante, on appelait ça le « nervous breakdown », ce qui est en fait la conséquence du « burn out ».
Le signe avant-coureur de l’implosion du salarié, c’est lorsqu’un léger filet de fumée lui sort par une oreille. C’est le « warm up » cervical, auquel succèdent immédiatement le « burn out », l’antidépresseur et la consultation d’un avocat.
Il y a ceux qui l’ont fait, ceux qui vont le faire et ceux qui s’en remettent dans une station thermale avec une couverture sur les genoux et une vue sur les reliefs du Morvan. Ce phénomène tendance intervient quand la saturation se présente. Il est le fait des mauvais traitements que l’on inflige à un salarié. A l’extrême cela peut conduire à des suicides en série, l’actualité en a déjà fait état. C’est pour cela qu’il est important de repérer les signes avant-coureurs et de reprendre en urgence le contrôle de son destin.
La crise encourage les mauvais managers ou du moins les dirigeants cyniques à abuser. Le « burn out » pousse au départ et favorise l’apport de « sang frais », expression maintes fois entendue depuis la guerre de quatorze et hautement significative. Untel s’enfuit épuisé quelque part dans le Lubéron exploiter des chambres d’hôtes et tel autre se présente, plein d’énergie pour le remplacer.
Stéphane Hessel recommandait de s’indigner ce qui n’est pas une bonne chose si cette manifestation n’est pas suivie d’effet. Non, ce qu’il faut, c’est considérer l’action inverse et donc opposer la désaturation, mot qui n’existe pas mais qui se comprend, à la saturation, mot qui existe au point de faire des ravages.
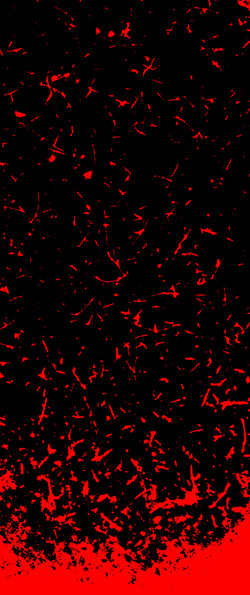 Puisque nous ne sommes pas, du moins officiellement, en camp disciplinaire, le refus (poli) de tâches en surnombre ne peut pas nous conduire au cachot pas plus qu’au peloton d’exécution. Encore que le refus soit un peu brutal pour le supérieur ou le collègue qui vous accable. La version plus « soft » consisterait donc à différer raisonnablement ce que l’on ne peut pas faire en même temps qu’autre chose. Ce que l’emmerdeur (deuse) ne peut pas comprendre lequel vous reprochera assez vite de ne pas savoir vous organiser et encore moins d’être capable de trier les priorités. « Priorité », cette fois le bon mot est lâché. En aucune façon, sauf à pousser des wagonnets au fin fond d’une mine sibérienne sous les ordres d’un primate tatillon, obligation n’est faite à quiconque de se délabrer volontairement le système nerveux jusqu’à l’inanition, l’anorexie ou l’obésité incontrôlées.
Puisque nous ne sommes pas, du moins officiellement, en camp disciplinaire, le refus (poli) de tâches en surnombre ne peut pas nous conduire au cachot pas plus qu’au peloton d’exécution. Encore que le refus soit un peu brutal pour le supérieur ou le collègue qui vous accable. La version plus « soft » consisterait donc à différer raisonnablement ce que l’on ne peut pas faire en même temps qu’autre chose. Ce que l’emmerdeur (deuse) ne peut pas comprendre lequel vous reprochera assez vite de ne pas savoir vous organiser et encore moins d’être capable de trier les priorités. « Priorité », cette fois le bon mot est lâché. En aucune façon, sauf à pousser des wagonnets au fin fond d’une mine sibérienne sous les ordres d’un primate tatillon, obligation n’est faite à quiconque de se délabrer volontairement le système nerveux jusqu’à l’inanition, l’anorexie ou l’obésité incontrôlées.
Nul n’est censé rester au milieu d’un champ de tir. Dans son premier livre, Roucou, le romancier et journaliste Jacques Perret, décrivait un instituteur un peu lassé de ses élèves chahuteurs. Du haut de sa chaire, regardant par la fenêtre, il confondait ce jour-là un ballon coincé dans les branches d’un arbre de la cour de récréation, avec une noix de coco. Les écharpes de ses élèves suspendues aux patères ondulaient comme des lianes ou des serpents. Alors, raconte le narrateur, il se leva, enfila son pardessus, mit son chapeau et partit.


j’aime beaucoup le titre de cet article, gardons le en tête pour le jour où …
Merci pour ces conseils! Oui au I-would-prefer-not-to pour tous…
Il est rare de citer Jacques Perret. Merci pour l’article également.